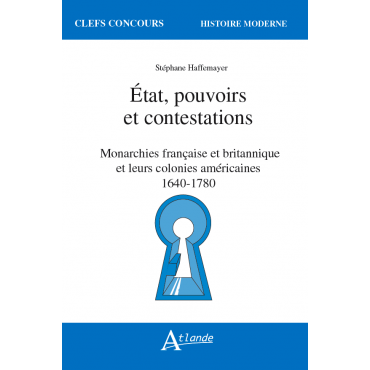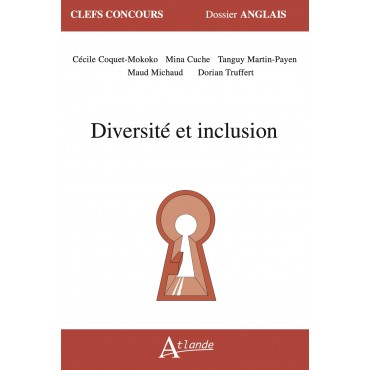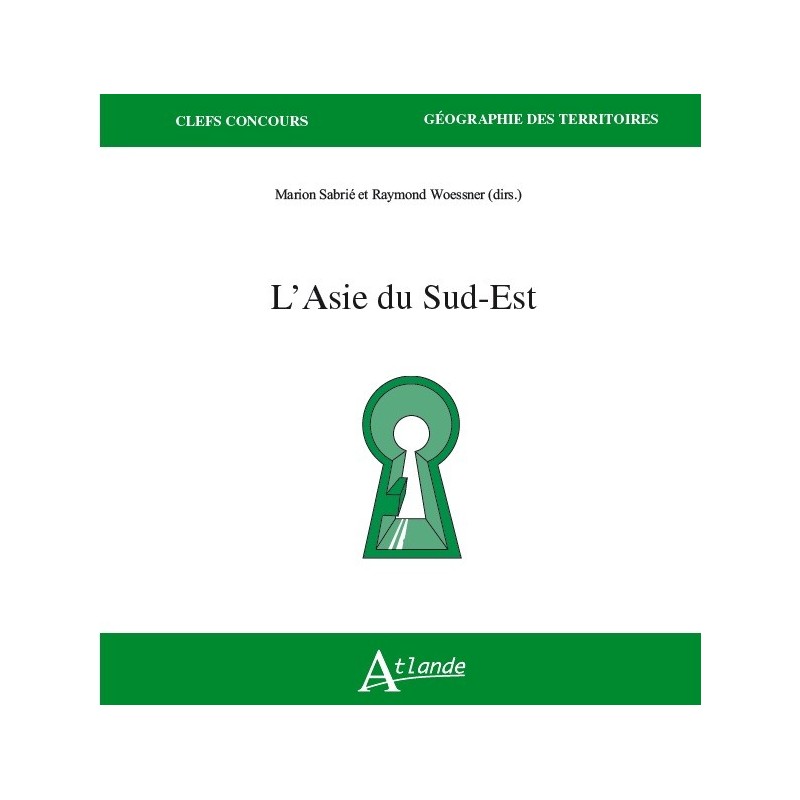
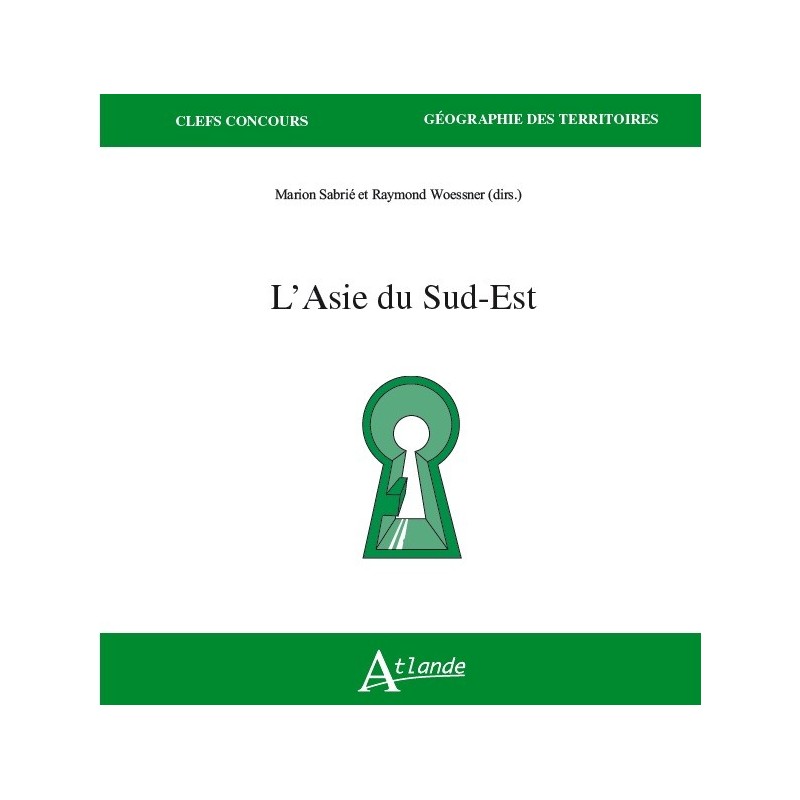
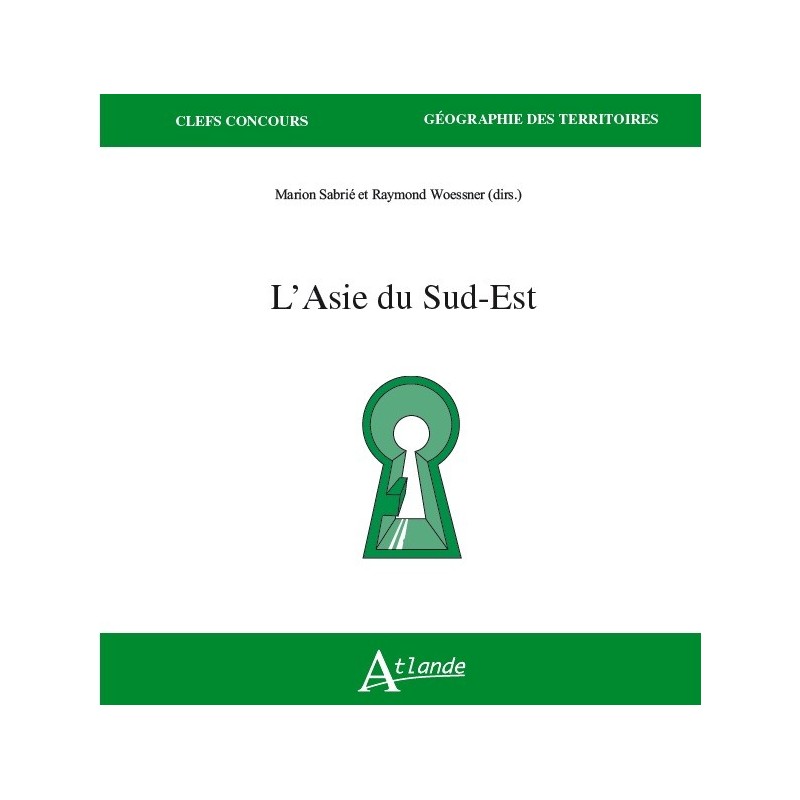
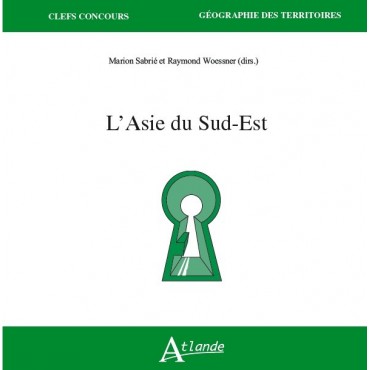
Dirigé par Marion Sabrié et Raymond Woessner
Agustina, Baffie, Bélizal, Boisseau du Rocher, Brennetot, Bruneau, Burnel, Côté-Douyon, Déry, Duchère, Guéguen, Heim, Lainé, Lazard, Madavan, Mariller, Michalon, Monot, Trang Nguyen, Rancourt, Roche, Scornet
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Traitant du sujet 2020 et 2021 de Géographie des territoires des agrégations d'Histoire et de Géographie ainsi que du capes d'Histoire-Géographie, cet ouvrage explore l'Asie du Sud-Est dans l'ensemble de ses dimensions.
Comme tous les clefs-concours, l'ouvrage est structuré en trois parties :
- Repères : le contexte historique
- Thèmes : comprendre les enjeux du programme
- Outils : pour retrouver rapidement une définition, une date, un personnage, une référence.
Fiche technique
SOMMAIRE
TABLE DES FIGURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UNE RÉGION À L’IDENTITÉ GÉOGRAPHIQUE COMPLEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Un espace fragmenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Des facteurs d’unité inégalement déployés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
UNE RÉGION DANS UN SYSTEME D’ENJEUX EMBOITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
L’Asie du Sud-Est, une pièce stratégique du système monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Une intégration régionale en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LES FORMES DE L’ÉMERGENCE ET SES REVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Une émergence inégale et inachevée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Des États en quête de stabilité géopolitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
La montée en puissance de nouveaux acteurs privés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Un environnement menaçant et menacé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NOMMER ET DÉLIMITER L’ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Un “angle de l’Asie” ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Asie des Moussons, Insulinde ou Indochine ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Extrême-Orient, Asie Orientale ou Asie du Sud-Est ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Une Asie du Sud-Est : définition d’une région et remise en question . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ENSEIGNER L’ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
L’ASIE DU SUD-EST DANS L’ÉVOLUTION DE LA GÉOGRAPHIE SCOLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
L’esprit des programmes scolaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
La place de l’Asie du Sud-Est dans l’histoire des programmes scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
UNE RÉGION SUD-EST ASIATIQUE DÉSORMAIS IGNORÉE DE LA GÉOGRAPHIE SCOLAIRE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
L’Asie du Sud-Est dans les programmes de collège de 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
L’Asie du Sud-Est dans les programmes du lycée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
REPÈRES
“L’ANGLE DE L’ASIE” : LA CONSTRUCTION GÉPOLITIQUE FACE AUX FORCES CENTRIFUGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
L’ASIE DU SUD-EST : UNE CONSTRUCTION EXOGENE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
L’Asie d’entre Inde et Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
L’Asie du Sud-Est : espace de colonisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
L’ASEAN, RÉFÉRENCE HISTORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
L’ASEAN, outil de consolidation stato-nationale et mécanisme de réconciliation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Des fonctions souples et larges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Un fonctionnement simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
L’ASIE DU SUD-EST ASPIRÉE PAR DE NOUVELLES DYNAMIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
La satellisation de l’Asie du Sud-Est ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
L’Indo-Pacifique : l’Asie du Sud-Est prise en tenaille ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Le retour de la Chine et la perspective de nouveaux conflits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LES QUERELLES POUR L’APPROPRIATION DE LA MER DE CHINE DU SUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Les acteurs de la mer de Chine du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Les principaux enjeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Ressources halieutiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Enjeux politiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
L’impact de la Convention de Montego Bay de 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Évolution historique et développements récents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
• Premiers accrochages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Face-à-face dans les Spratly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
De l’Impeccable à la plateforme 981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
• Les constructions artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Géographie militaire de l’Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
• Les rôles des militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Fonctions conventionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ces généraux qui gouvernent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Les “armées rouges” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fonctions économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
• Conflits dormants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
• Conflits actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
LES FONDEMENTS ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN ASIE DU SUD-EST :
DÉCOLONISATION, INDUSTRIALISATION, LIBÉRALISATION ET MONDIALISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Croissance et déclin de l’Asie du Sud-Est du milieu du XIXe siècle aux années 1950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Instabilités politiques et programmes de nationalisation aux Philippines, en Birmanie et en ex-Indochine. . . . . . . . . . . . . 75
Ressources naturelles, industrialisation et ouverture à l’étranger en Indonésie, Singapour, Malaisie, Thaïlande et Brunei . . 77
L’Asie du Sud-Est dans l’économie capitaliste globalisée des années 1980 à aujourd’hui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
L’intégration économique incomplète en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
L’Asie du Sud-Est, un modèle de croissance pour les pays en développement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
LES MUTATIONS AGRICOLES CONTEMPORAINES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
La riziculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• L’autosuffisance en riz, une donnée géostratégique et politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• Techniques et paysages variés des rizières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
L’huile de palme, boom économique, problème environnemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
L’Asie du Sud-Est, exportatrice des produits du secteur primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
• Le riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
• Le teck, un bois recherché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
• Les agglomérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
• D’une agriculture vivrière et de l’autosuffisance agricole aux cultures commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
• La révolution du monde agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
La Révolution verte en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
De nouveaux agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LE BOOM DES TRANSPORTS AU LONG COURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
LE BOOM DU TRANSPORT MARITIME ET LE MODELE SINGAPOURIEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
UN TRAFIC AÉRIEN EN PLEIN DÉVELOPPEMENT EN ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Un nouvel espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Le rôle du transport aérien low cost aux Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Un secteur en plein essor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
• Le transport aérien relais du transport maritime pour le transport passager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
• La croissance du trafic domestique par le Low Cost Carrier (LCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
La concentration croissante des acteurs du LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
• Cebu Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
• Air Asia Philippines issue de la recomposition de plusieurs entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
• Pal express, filiale low cost de PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
De nouvelles infrastructures aéroportuaires en vue d’une réorganisation des centralités et des flux aériens . . . . . . . . . . . 116
• L’aéroport de Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
• Un autre grand projet qui concerne aussi l’île de Luçon et la province de Bulacan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Aéroport et compagnies aériennes créatrices de destinations touristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Le concept de couloir ou de corridor comme facteur structurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
LE TOURISME EN ASIE DU SUD-EST : UNE AFFAIRE DOMESTIQUE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Trajectoires récentes du tourisme en Asie du Sud-Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Quel tourisme domestique en Asie du Sud-Est ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
• Des chiffres à la hausse… presque partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
• Qui sont les touristes domestiques en Asie du Sud-Est ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Motivation des voyages du tourisme domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Émergence d’une classe moyenne qui voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
• Le Cambodge : un cas particulier de tourisme domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Le cas du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
• Le tourisme domestique en pleine expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
• Potentiels et retombées socio-économiques du tourisme au Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
La durabilité, nouvel enjeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
POPULATIONS ET DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES PAYS D’ASIE DU SUD-EST : UNE HISTOIRE EN ACCÉLÉRÉ . . 141
LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION HUMAINE ET DE LA TRANSITION URBAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
LES ENJEUX D’UN ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE ABSOLU CONSIDÉRABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
DIFFÉRENTS MODÈLES DE TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Des baisses considérables de la mortalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Une transition accélérée de la fécondité marquée par des variations d’intensité et de calendrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Une planification familiale d’État : le cas du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
• Fondation de la norme familiale socialiste (1961-1980). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
• Les années 1980-1990 : propagande de masse et encadrement des populations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
• Les années 2000 : gestion étatique de la quantité et de la qualité de la population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
LES OPPORTUNITÉS DE L’IMPORTANT DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
UN DÉFI MAJEUR DE DEMAIN : LE VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ DE LA POPULATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
LA QUESTION DU GENRE EN ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
NOTIONS THÉORIQUES ET CONTEXTUELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
ÉVOLUTION DE L’ÈRE COLONIALE À NOS JOURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LA CONDITION DE LA FEMME EN ASIE DU SUD-EST :
DU FOYER À LA SPHÈRE PUBLIQUE EN PASSANT PAR L’ACCÈS À L’EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
FOCUS SUR LA BIRMANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Quelles opportunités au sein de la société civile ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
La question du genre en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
• Agendas internationaux et nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
• Aspects culturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Domaines d’action laissés aux femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Médias et Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
TYPOLOGIE DES MOBILITÉS ET MIGRATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
LES MIGRATIONS INTÉRIEURES : LES EXEMPLES DE LA THAÏLANDE ET DU VIETNAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
LES MIGRATIONS INTERNATIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
SYSTEMES MIGRATOIRES ET ESPACES RÉSEAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Le système péninsulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Le système archipélagique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Les réseaux nés de la crise communiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Départs volontaires : la communauté transnationale philippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
DE LA TROPICALITÉ A LA GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
LA MORPHOLOGIE ET LA BIOGÉOGRAPHIE DU SUD-EST ASIATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
L’Asie du Sud-Est péninsulaire, entre confins himalayens et anciennes plates-formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
• Les confins himalayens en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
• Les reliefs du centre de la péninsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
• Plaines et bassins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Les arcs insulaires indonésiens et philippins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Des îles majoritairement volcaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
LA TROPICALITÉ PAR LE CLIMAT, LES SOLS ET LA BIODIVERSITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Le climat tropical de mousson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Types de sols en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
• Les sols zonaux : sols forestiers, latérite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
• Les sols azonaux alluviaux et volcaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
La biodiversité, somptueuse et menacée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
• Les biomes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
• Les menaces sur la biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
UNE UNITÉ PAR LA VULNÉRABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Les risques tsunami et cyclonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Les aléas tsunami et cyclonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
• Les tsunamis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
• Les cyclones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Des enjeux aux vulnérabilités diverses mais complémentaires et complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Le cas du cyclone Nargis et la gestion de la catastrophe humaine en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
• Un cyclone tropical d’une force inhabituelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
• Des dégâts humains et économiques majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
• Une gestion du risque trop tardive par les autorités birmanes, concentrées sur le référendum constitutionnel . . . . . . 198
• L’ingérence de la communauté internationale et des grands bailleurs :
une réponse standardisée inadaptée aux besoins locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
LA PRÉVENTION DES RISQUES, ENTRE PRISE DE CONSCIENCE ET DÉFIS POUR LA COOPÉRATION. . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ESPACES
LA MÉTROPOLISATION EN ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉMERGENCE MÉTROPOLITAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
SINGAPOUR COMME RÉFÉRENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Un territoire intégré à la mondialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
• Un site et une situation exceptionnels mis à profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
• Un essor économique fondé sur l’insertion à la mondialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
• Une métropole mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Un territoire moteur à l’échelle régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
• Un hub de redistribution en Asie Pacifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
• Un État investisseur en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
• Singapour en Asie du Sud-Est, entre intégration et concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Une cité-État en permanente “révolution du territoire”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
• Un territoire façonné et spécialisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
• Une société singapourienne multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
• Un État omniprésent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
• Le choix de la ségrégation géographique des communautés à Singapour sous l’ère coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
• La crise urbaine à la veille de l’indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
• L’accession à l’indépendance et le choix de la promotion du multiculturalisme CMIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Une révolution du territoire pour mettre fin à la ségrégation coloniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
La politique de promotion de territoires “vitrines” des identités des communautés CMIO par l’État . . . . . . . . . . . 241
HANOÏ ET LE DELTA DU TONKIN : UNE MÉTROPOLE QUI VEUT ÉMERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
La “civilisation urbaine” au secours de l’État-parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
• Pouvoir et territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
• Le discours international sur le genre en planification urbaine et sa réception au Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
• La “civilisation urbaine”, un projet hégémonique… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
• … et autoritaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Arrangements, résistances et révoltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Corporatisme d’État-parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Compromis, résistances du quotidien et gouvernance itérative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• Révoltes foncières ou désaveu politique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Les enjeux socio-spatiaux de la métropolisation de Hanoï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
• De capitale d’empire à métropole régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
• Hanoï et sa nouvelle province élargie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
• Hanoï et son aire métropolitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
La fabrique urbaine : diversité des acteurs et enjeux de la “conversion foncière” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
• Une “terre sans prix” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
• L’urbanisation par le haut : décentralisation et collusions public-privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
• Encourager le développement provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
• L’urbanisation par le bas ou comment les habitants négocient leur place dans la métropolisation . . . . . . . . . . . . . . . 261
• Augmentation des inégalités socio-spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Vulnérabilité urbaine et dégradation écologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
EN BIRMANIE, LES CAS DISTINCTS DE YANGON ET NAYPYIDAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
La métropolisation émergente de Yangon et ses conséquences socio-spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
La croissance urbaine sans précédent et désorganisée de Yangon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
• La congestion massive comme principale externalité négative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
• Le “droit à la ville” birmane : la lente diffusion d’un concept exogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
La métropolisation de Yangon, source de plus grandes injustices socio-spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Le droit à la ville de tous les Yangonais bafoué ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
La ville nouvelle de Naypyidaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
• Un site très symbolique à proximité d’un ancien foyer de peuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
• Un site défensif et à proximité des États ethniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
• Naypyidaw, la capitale administrative et diplomatique, et Yangon, la capitale économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
MOBILITÉS, FLUX ET TRANSPORTS À L’ÉCHELLE URBAINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Les transports et les mobilités dans la ville en développement, quels défis ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Bandung, une capitale provinciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
• Les lacunes du système de transport public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
• L’arbitrage des ménages en faveur des deux-roues motorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Yangon : la fragmentation de la gouvernance des transports urbains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
• Une politique municipale de transport limitée et des stratégies de substitution au transport public favorisant la congestion . 285
• Les débuts insuffisants d’une solution de transport public avec l’expertise japonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
L’HABITAT INFORMEL, UNE TRES GRANDE VARIÉTÉ DE RÉALITÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Le développement des logements informels à Yangon, réaction à une offre de logements inadaptée . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Les autorités publiques entre la difficile reconnaissance des bidonvilles et la volonté d’éradication. . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Hlaingthayar, principal quartier informel de Yangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Les bidonvillois tamouls de Kampung Padan face à la politique d’éradication des logements informels à Kuala Lumpur . 293
DES LIGNES DE CRETE AUX LITTORAUX : LA REMISE EN CAUSE DU TEMPS LONG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
LES HAUTES TERRES OU MONTAGNES NORD-INDOCHINOISES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
“Montagnards” et groupes ethniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
La Zomia ou périphérie de l’Asie du Sud-Est continentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
• Étagement et stratification ethnique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
• Les sociétés égalitaires des hauteurs en marge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
L’ESPACE DES SOCIÉTÉS À ÉTAT DES BASSES TERRES : LES ÉTATS-MANDALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
L’étage intermédiaire austro-asiatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
L’effacement progressif de l’étagement ou de la stratification ethnique en Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
La stratification ethnique des montagnes est-elle en voie de disparaître ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
FOCUS SUR LA VALLÉE DE L’IRRAWADDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Le très lent déclin de la première grande région agricole birmane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
La vallée de l’Irrawaddy, le “bol de riz birman” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
L’Irrawaddy, la vallée agricole traditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Des ressources ligneuses centrées sur la vallée de l’Irrawaddy ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
LES FLEUVES D’ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Les fleuves d’Asie du Sud-Est continentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
• Le Mékong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
• Le réseau hydrographique birman dominé par la vallée de l’Irrawaddy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
• La Salouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
• Le Ménam Chao Phraya, un fleuve national à la vallée incontournable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
• Les deltas très peuplés des grands fleuves continentaux
Les fleuves d’Asie du Sud-Est insulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
• Les fleuves de Malaisie : entre écosystèmes pollués et cultures commerciales intensives et riveraines . . . . . . . . . . . 338
• Le réseau hydrographique d’Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
• Les cours d’eau majeurs des Philippines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Le retour du rôle du fleuve en ville : le cas de l’Irrawaddy en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
• Une réappropriation des rives ou les fonctions fluviales contemporaines en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
• Une rive peu dédiée à la restauration et à l’hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
• Une rive essentiellement portuaire lentement colonisée par les infrastructures touristiques et de loisir . . . . . . . . . . . 342
L’AQUACULTURE EN ASIE DU SUD-EST : L’EXEMPLE DU POISSON-CHAT AU VIETNAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
L’aquaculture vietnamienne traditionnelle avant les années 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
La “success story” du Pangasius vietnamien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Le défi du changement climatique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
ARCHIPELS ET RUGOSITÉ DE L’ESPACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Le lien indispensable des ferries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Un projet étatique : déplacer les populations pour développer et contrôler Mindanao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
• Historique de Mindanao aux Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
• Dynamiques spatiales contemporaines des populations indigènes : le cas des Blaans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
• Mindanao : les relais du développement dans un cadre régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
CHINE ET ASIE DU SUD-EST : LES TROIS FRONTIERES TERRESTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
La réinvention des frontières : la Chine comme opportunité et comme menace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Birmanie, Vietnam, Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
La pénétration chinoise en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
La Birmanie, pays charnière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
La frontière sino-vietnamienne entre confrontation et compénétration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
La pénétration chinoise au Laos septentrional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Les projets avortés du percement d’un canal maritime dans l’isthme de Kra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
LA RÉGION DU GRAND MÉKONG (RGM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Un programme d’intégration transnational sous l’égide de la Banque Asiatique de Développement. . . . . . . . . . . . . . . . . 377
La reconfiguration urbaine à l’échelle de la région : têtes de corridors, villes relais et doublons frontaliers . . . . . . . . . . . 378
La valorisation des villes frontalières situées sur les corridors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
• Un changement d’échelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
• Les villes frontalières dans la planification nationale : l’exemple de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
• L’internationalisation : le cas des doublons Mukdahan-Savannakhet et Chiang Khong-Houay Xay. . . . . . . . . . . . . . 383
Des villes périphériques aux nœuds structurants des corridors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Des doublons support des flux commerciaux régionaux accélérés par les projets de la RGM dans la période 2000-2010 . 384
Les transformations des villes frontalières : une internationalisation accrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
• Un processus porté par des acteurs variés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
• Une reconfiguration urbaine par les flux d’IDE : l’exemple de la zone en tête de pont à Savannakhet. . . . . . . . . . . . 386
• L’impact inégal de l’intégration régionale sur l’organisation spatiale des villes frontalières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
CONFLITS AUTOUR DES DIASPORAS ET DES ETHNIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
LES CONFLITS ETHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Les révoltes millénaristes, premiers conflits “ethniques” de l’histoire du Sud-Est asiatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Les conséquences de la colonisation (et semi-colonisation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
La “semi-colonisation” et la naissance du nationalisme au Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Les Jawi du sud de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Les Moros du sud des Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Birmanie : reprise de la guérilla kachin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
• Le poids persistant des militaires en Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
• Un corps national de garde-frontières refusé par des groupes armés ethniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
• Les déplacés kachin dans des camps rudimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Des minorités musulmanes en révolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
MOBILITÉS, MIGRATIONS, DIASPORAS EN ASIE DU SUD-EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Les facteurs de l’accroissement récent des mobilités et migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
• La transition agraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
• L’urbanisation et l’industrialisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
• Les politiques de redistribution spatiale de la population. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
• Les politiques d’exportation de la main-d'œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
• Le cas de la diaspora hmong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Les Chinois en Asie du Sud-Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
• Panorama de la présence chinoise en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Les Chinois d’Indonésie, le renouveau après les épreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Les Chinois des Philippines : l’insécurité durable n’exclut pas l’ascension sociale et la mixité . . . . . . . . . . . . . . . 403
Les Chinois du Vietnam : tenus pour l’ennemi héréditaire, ils doivent toujours avoir leur valise prête . . . . . . . . . . 404
Peu de place pour les Chinois dans le Cambodge des Khmers Rouges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Les Chinois de Birmanie : un voisin envahissant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Les Chinois de Malaisie et le parti communiste de Malaisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Les Chinois de Thaïlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
• Communautés chinoises outre-mer et nouveaux migrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
• Divisoria au cœur des dynamiques urbaines entre Sino-Philippins et nouveaux migrants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
• Des activités économiques qui épousent et modifient les centralités urbaines voire nationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
La restauration “rapide”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Une implication plus grande dans le tertiaire commercial et foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
La distribution et des centres commerciaux adaptés à la population locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
• Territoires chinois et violences dans le contexte du Sud-Est asiatique contemporain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Les atteintes aux personnes : les populations chinoises ciblées lors des crises politiques et économiques . . . . . . . 415
La destruction des invariants communautaires : les cimetières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
• Les communautés chinoises outre-mer à l’interface des demandes politiques de la Chine continentale :
des enjeux territoriaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Les autres diasporas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
• Les Vietnamiens du Laos et du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
• Les Hmongs du Laos et du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
• Les ethnies minoritaires de Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
• Les Papous d’Indonésie en révolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
• Quand le facteur ethnique permet la solution d’un conflit : le cas des “Chams” de Ban Khrua à Bangkok (Thaïlande) . 421
• Un conflit d’ordre linguistique aux Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
• Les “Rohingya” d’Arakan : une crise sans issue ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
OUTILS
CHRONOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
OUVRAGES ET ARTICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
VIDÉOS ET RESSOURCES WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
SIGLES ET ACRONYMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
TABLE DES FIGURES
Fond de carte pour l’Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Les pays d’Asie du Sud-Est : récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Données sur le développement et la condition des femmes en Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Les corridors dans la péninsule Indochinoise et l’Archipel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dates de ratification des accords UNCLOS 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pays riverains de la mer de Chine Méridionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Personnel actif et budget annuel des forces armées sud-est asiatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
La croissance de la production de riz, en millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Contrastes grandissants sur le marché international du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Population travaillant dans le secteur primaire en Asie du Sud-Est par pays (2013-2017) (en %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Le secteur primaire dans le PIB des pays d’Asie du Sud-Est (1990-2017) (en %). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Les grands ports de l’Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Les aéroports du Sud-Est asiatique parmi les 50 premiers mondiaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Nombre d’avions par compagnie aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Aéroports indonésiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Les principaux aéroports domestiques aux Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Les aéroports de Clark, restructurant NAIA, et de Bulacan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Palawan et le développement de l’aérien low cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Origine des arrivées touristiques internationales en Asie du Sud-Est, 2015 (en %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Augmentation annuelle des dépenses du tourisme domestique en Asie du Sud-Est de 2007 à 2017 (en %) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Population et touristes domestiques en Asie du Sud-Est (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Nombre de visiteurs domestiques et internationaux par pays, vers 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Population, urbanisation et classe moyenne en Asie du Sud-Est, 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Indonésie, population en fonction des dépenses mensuelles des foyers (en %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Vietnam, touristes domestiques, 2000-2018 (en millions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Dépenses des touristes domestiques au Vietnam (en % du total dépensé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Les effectifs et la densité de population des pays de l’Asie du Sud-Est en 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Populations d’Asie du Sud-Est et croissances démographiques de 1950 à 2050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Évolution du taux d’accroissement annuel moyen (en %), 1950-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Espérance de vie à la naissance dans les pays d’Asie du Sud-Est, 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Taux de mortalité infantile* dans les pays d’Asie du Sud-Est, 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raymond Woessner est professeur honoraire à la Sorbonne.
Marion Sabrié est docteur en géographie et enseignante à l'INALCO.
Ratna Agustina est urbaniste, maître de conférences à l’Institut Teknologi National, Bandung en Indonésie et spécialiste de transport urbain. Elle se concentre sur le système de transport durable en développant une meilleure compréhension de l’impact de la configuration de l’utilisation des sols, de la forme urbaine sur le comportement des déplacements afin de prendre des décisions stratégiques en matière de planification des transports. Elle a acquis une expérience internationale en rejoignant plusieurs projets et études en France, y compris la recherche sur la modélisation du transport de marchandises en Europe. Elle a aussi mené de nombreuses études sur la mobilité, les transports en commun, les émissions de véhicules et le choix des modes de transport. Elle a rédigé le chapitre sur la mobilité à Bandung.
Socio-anthropologue et historien spécialiste de la Thaïlande, Jean Baffie est actuellement chercheur associé à l’Institut de Recherches Asiatiques (CNRS-Aix-Marseille Université). Chercheur au CNRS de 1992 à 2016, il a été directeur de l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (CNRS-Université de Provence) de 2004 à 2007 et directeur de la Maison Asie-Pacifique (CNRS-EHESS-Aix-Marseille Université) de 2008 à 2011. Sa bibliographie est disponible à l’adresse https://journals.openedition.org/moussons/4090. Il a rédigé le chapitre dédié aux conflits ethniques.
Édouard de Bélizal est docteur en géographie et professeur en classes préparatoires aux Grandes Écoles à Lyon. Il travaille sur les risques associés au volcanisme en Indonésie. Il est l’auteur du chapitre sur les milieux et les paysages.
Sophie Boisseau du Rocher, docteure en Sciences politiques de l’IEP de Paris, est chercheure au Centre Asie de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales). Elle travaille sur les dynamiques régionales en Asie du Sud-Est ainsi que sur les évolutions politiques et géopolitiques des pays-membres de l’ASEAN. Elle collabore à de nombreux ouvrages et revues en Europe et en Asie du Sud-Est. Elle a écrit le chapitre consacré à la géopolitique et à l’ASEAN.
Arnaud Brennetot est professeur de géographie à l’université Rouen-Normandie et membre de l’UMR CNRS 6266 IDEES. Il est spécialiste de géographie politique et s’intéresse aux relations entre les systèmes idéologiques et les politiques territoriales. Il travaille en particulier sur la néolibéralisation des territoires. Il a été membre du jury de l’agrégation externe de géographie entre 2015 et 2018. Il a coécrit l’introduction.
Michel Bruneau, agrégé de géographie, Directeur de Recherche émérite au CNRS, a mené des recherches en Thaïlande et dans divers pays de l’Asie du Sud-Est, depuis 1966, à diverses échelles, du local au continental. Sa thèse d’État a porté sur l’organisation de l’espace dans le nord de la Thaïlande. Il a codirigé le volume Asie du Sud-Est-Océanie (1995) de la Géographie Universelle RECLUS (Belin, Roger Brunet dir.) et dirigé la partie Asie du Sud-Est du livre-atlas Asies Nouvelles (Belin, 2002, Michel Foucher dir.). Il a publié en 2006 un essai de géohistoire L’Asie d’entre Inde et Chine : Logiques territoriales des États (Belin). Il a également travaillé sur les Diasporas et espaces transnationaux (Anthropos-Economica, 2004) et a récemment participé au livre Géopolitique de l’Asie (Nathan, 2017, sous la direction de Nicolas Balaresque).
Géographe des risques, professeur indépendant et vacataire de l’Éducation nationale, Mathis Burnel est spécialisé dans la prévention du risque tsunamis. Il a d’abord travaillé au sein de la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO et de la Disaster Risk Reduction and Recovery Unit de l’UNDP (à Bratisalva), notamment sur la mise en place d’un système d’alerte aux tsunamis et des projets de réduction des risques. Il a également fait partie du projet européen ASTARTE au sein du Labex Dynamite et du Laboratoire de Géographie Physique à Paris. Il a ensuite consacré ses recherches aux inégalités des chances face au risque tsunami et aux implications pour la planification des évacuations. Il est l’auteur du chapitre consacré à la gestion des risques.
Diplômée en maîtrise d’urbanisme de l’Université de Montréal et candidate au doctorat en études urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Montréal, Mélissa Côté-Douyon continue ses recherches sur les questions du genre et de la ville. Sa thèse porte sur l’approche de genre en planification urbaine et son adoption au Vietnam. Les données présentées dans l’encadré consacré au discours international sur le genre en planification urbaine et sa réception au Vietnam découlent d’une recherche de terrain qu’elle a menée au Vietnam en 2018 et 2019.
Steve Déry est professeur titulaire au département de géographie de l’Université Laval. Ses recherches portent surtout sur les transformations des régions rurales d’Asie du Sud-Est continentale, plus spécialement celles du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Il a écrit La colonisation agricole au Vietnam (PUQ, 2004) et ses recherches récentes l’ont amené à étudier “À qui appartiennent les paysages en Asie ?”, en particulier là où des régions marginales ont été ouvertes au tourisme. Ses thèmes privilégiés portent sur l’État, les minorités ethniques, la marginalité, les paysages. Il a coécrit le chapitre consacré au tourisme domestique.
Yves Duchère, géographe spécialiste du Vietnam est actuellement ATER à l’INALCO et chercheur associé au CESSMA. Il est l’auteur de plusieurs articles et d’un ouvrage sur la gouvernance urbaine et la métropolisation au Vietnam. Il est l’auteur du chapitre sur la gouvernance et fabrique urbaine sous des régimes autoritaires à travers l’exemple vietnamien et du chapitre dédié à la métropolisation et ses conséquences socio-spatiales.
Catherine Guéguen est géographe, docteure de l’université Paris IV. Elle a soutenu une thèse sur les Philippines en 2007 (“Les Chinois de Manille, Ancrage et évolutions socio-spatiales”) sous la direction d’Olivier Sevin. Pour mener à bien son terrain de thèse, elle a travaillé au lycée français de Manille de 2001 à 2004. Elle enseigne actuellement en collège et en lycée dans l’académie de Rennes et donne des cours de géographie dans le cadre du DAEU à l’UBO depuis 2016. Associée à l’UMR 8586 (PRODIG) et l’Institut Convergence Migrations (ICM), ses recherches actuelles intègrent les mobilités et la comparaison des implantations des Chinois outre-mer dans les villes de Manille et Kolkata. Son deuxième angle d’étude relève de la compréhension des centralités dans l’agglomération-capitale des Philippines où elle séjourne tous les ans. Elle a rédigé les chapitres consacrés aux Chinois en Asie du Sud-Est, au transport aérien aux Philippines et à la Transmigration à Mindanao.
Stéphane Heim, sociologue, maître de conférences à l’université de Kyôto (Japon), travaille sur les industries et marchés automobiles, et les relations de travail en Asie. Dans une perspective de sociologie économique, il consacre une grande partie de ses travaux actuels aux effets de la (dé)mondialisation sur les espaces de production, les trajectoires d’internationalisation, les modes de consommation, les relations salariales et la transition vers des modèles productifs alternatifs des industries automobiles asiatiques. Il est, entre autres, membre du comité international du GERPISA (réseau international de chercheurs en sciences sociales sur l’automobile, http://gerpisa.org/), et du comité de rédaction de la revue International Journal of Automotive Technology and Management. Il est par ailleurs coresponsable d’un séminaire de jeunes chercheurs sur la sociologie de l’Asie de l’Est, liant l’université de Kyôto, l’université nationale de Séoul et l’université nationale de Taïwan. Il a écrit le chapitre sur l’économie de l’Asie du Sud-Est.
Elsa-Xuân Lainé est titulaire d’un doctorat en Géographie obtenu en décembre 2013 à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Ses recherches portent sur les transformations des villes frontalières de la Thaïlande dans le contexte de la régionalisation et de l’intégration transnationale. L’essentiel des données présentées dans cette contribution a été collecté au cours de terrains de recherche menés en Asie du Sud-Est continentale entre 2009 et 2012. Elle a rédigé le chapitre consacré aux transformations des espaces frontaliers par la régionalisation.
Jérôme Lazard, docteur ingénieur habilité à diriger des recherches (HDR), est spécialiste d’aquaculture tropicale et a exercé son activité au sein du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) dont il a dirigé l’unité de recherche “Aquaculture”. Il a conduit des projets de recherche et de R&D en Côte d’Ivoire, au Niger et en Ouganda et a réalisé des missions d’appui scientifique, technique et de formation dans une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du sud et du sud-est. Il est membre de la Society of Aquaculture Engineers of the Philippines, de la Sociedade Brasileira de Aqüicultura et de l’Académie d’agriculture de France. Il est l’auteur du chapitre sur l’aquaculture.
Delon Madavan, géographe, est chercheur associé au Centre d’études de l’Inde et l’Asie du Sud (CEIAS - EHESS/CNRS) et au Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS - Université de Québec à Montréal). Dans le cadre de sa thèse, il a travaillé sur l’intégration socio-spatiale de la minorité tamoule à Colombo, Kuala Lumpur et Singapour. Il a comparé, à l’aide de ces trois terrains asiatiques, les différents modes et degrés d’intégration des minorités tamoules, tant localement (en évaluant leur “citadinité”) ou nationalement (en évaluant leur citoyenneté) que mondialement (en situant leurs “transnationalités” diasporiques). Il a écrit le chapitre consacré aux ethnoterritoires de Singapour et celui sur les bidonvilles de Kuala Lumpur.
Initialement diplômée en Tourisme, Manon Mariller étudie actuellement l’environnement et la coopération au développement à la Faculté de Géosciences et d’Environnement de l’université de Lausanne. Elle mène ses recherches sur les associations féministes basées à Yangon, en Birmanie, et leur implication dans la société civile.
Martin Michalon est un ancien élève de l’ENS de Lyon et agrégé de Géographie. Il est doctorant à l’EHESS, au sein du Centre Asie du Sud-Est (CASE). Sa thèse porte sur l’économie politique du tourisme en Birmanie. Il est l’auteur de l’encadré sur les Rohingya.
Alexandra Monot est géographe, agrégée et docteure. Elle est PRAG à l’université de Strasbourg où elle est responsable de la préparation aux concours. Ses travaux portent principalement sur le développement durable, les espaces ruraux et la géographie économique. Dans le présent ouvrage, elle a notamment rédigé les chapitres sur Singapour et la place de l’Asie du Sud-Est dans la géographie scolaire.
Thanh Trang Nguyen est doctorante au département de géographie de l’université Laval. Sa thèse porte sur la mise en œuvre et la durabilité du tourisme communautaire au Vietnam. Au Vietnam, elle était vice-doyenne de la Faculté de tourisme de l’université Van Lang à Ho Chi Minh ville. Elle a coécrit le chapitre consacré au tourisme domestique.
Jean-François Rancourt est doctorant en Science politique à l’université de Montréal (Canada). Spécialisé en politique comparée et en relations internationales, ses intérêts académiques portent principalement sur l’autoritarisme et les transformations des régimes politiques en Asie de l’Est et du Sud-Est. Fasciné par les multiples rôles joués par les militaires birmans, il travaille actuellement sur un projet de thèse portant sur la question de la censure de la musique en Birmanie. Il a contribué à l’ouvrage en rédigeant la section sur la géographie militaire de l’Asie du Sud-Est.
Yann Roche, géographe, est professeur à l’Université du Québec à Montréal, et il travaille sur la gestion des ressources naturelles en Asie du Sud-Est, notamment via l’utilisation des systèmes d’information géographique et de la cartographie. Il se spécialise sur le Vietnam et le Laos et se rend régulièrement dans la région depuis 1994. Il a écrit le chapitre consacré à la mer de Chine méridionale.
Marion Sabrié a consacré sa thèse au rôle joué par le fleuve Irrawaddy dans l’intégration nationale et internationale de la Birmanie. Elle travaille aujourd’hui sur la métropolisation de Yangon et ses défis. Sa thèse porte sur le rôle joué par le fleuve Irrawaddy dans l’intégration nationale et internationale de la Birmanie. Elle s’est investie dans la préparation des concours de l’enseignement, en particulier dans les Master MEEF à l’université Paris XIII, ainsi qu’à l’université Rouen-Normandie. Elle a aussi enseigné la géographie de l’Asie du Sud-Est à l’Institut national des langues et des civilisations orientales (INALCO) à Paris pendant plusieurs années. Elle a rédigé les chapitres consacrés aux fleuves, à nommer et délimiter l’Asie du Sud-Est, aux logements informels, les encadrés sur la métropolisation de Yangon, le “droit à la ville”, la mobilité à Yangon, Naypyidaw, la pêche en Birmanie, le cyclone Nargis et les populations déplacées du nord de la Birmanie et coécrit l’introduction et le chapitre dédié à l’agriculture.
Catherine Scornet, socio-démographe, est maître de conférences au département de sociologie de l’université Aix-Marseille, et chercheur au Laboratoire population, environnement, développement (LPED/UMR 151 IRD – AMU). Ses recherches actuelles, menées en partenariat avec l’Institut de sociologie (Académie de Sciences sociales du Vietnam), portent sur la politisation et la construction sociale de la sexualité au Vietnam et se placent dans la continuité de ses travaux sur les politiques de régulation de la fécondité et les changements reproductifs, dans une confrontation permanente entre le global et le local. Elle a écrit le chapitre consacré à la démographie en Asie du Sud-Est.
Raymond Woessner, agrégé de Géographie, professeur honoraire de l’université Paris-Sorbonne où il a dirigé le master Transport, logistique, territoire et environnement, est directeur de la publication pour la géographie aux éditions Atlande. Il a publié Atlas de l’Alsace, enjeux et émergences en 2019 et prépare un ouvrage sur le transport aérien face au choc carbone pour 2020. Il a coécrit le chapitre dédié à l’agriculture, ainsi que contribué aux chapitres sur les transports, notamment portuaires et aériens, les villes et la métropolisation.
INTRODUCTION
La géographie des grandes régions du monde représente un champ d'étude à la fois classique et en perpétuelle évolution (RICHARD et MAREÏ, 2018). Niveau intermédiaire entre le monde et les États, l'approche macrorégionale (que l'on appellera régionale par la suite puisque l'on se concentrera sur une région spécifique) offre un terrain d'observation idéal pour saisir la manière dont les logiques d'intégration et de fragmentation se conjuguent dans l'espace. Elle ne se réduit ni à l'encyclopédisme propre au continentalisme épistémologique (GRATALOUP, 2009), ni au souci d'offrir une classification descriptive de l'espace mondial. La régionalisation du monde est en effet devenue un phénomène mouvant (BECKOUCHE, 2008) et une réalité concrète, souvent lourde d'enjeux pour les acteurs territoriaux. L'intégration régionale des systèmes de flux (migratoires, commerciaux, touristiques), la multiplication des organisations et des accords intergouvernementaux régionaux, la multipolarisation de la puissance géopolitique et géoéconomique attestent de la vivacité du fait régional. C'est la raison pour laquelle, outre la géographie, nombre de sciences sociales s'y intéressent également: l'histoire, les sciences politiques et juridiques, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, etc. La reconfiguration des grands ensembles régionaux apparaît ainsi comme le corollaire de la mondialisation (que l'on aurait tort de confondre avec un simple phénomène d'uniformisation géographique).
À cette aune, l'Asie du Sud-Est apparaît comme une région participant activement à cette recomposition progressive du monde (FRÉCON et PAUTET, 2015; TERTRAIS, 2002). Tout en étant porteuse d'héritages complexes, elle s'affirme comme un espace régional en cours d'intégration et ouvert sur l'extérieur. Ainsi, et au-delà de son intérêt intrinsèque, la connaissance de la géographie de l'Asie du Sud-Est est donc susceptible d'aider à répondre aux nombreux objectifs contemporains que se donnent la recherche scientifique comme la discipline enseignée.
C'est pourquoi se pose la question de la territorialisation de la région du Sud-Est asiatique. Trois conditions sont nécessaires pour faire territoire: un sentiment partagé d'appartenance ; un jeu d'acteurs qui sont actifs dans différentes sphères ou forums; un projet pour un destin commun (WOESSNER, 2010). Il apparaît que la région est entrée plus tardivement dans la mondialisation contemporaine que l'Asie du Nord-Est. Elle est restée sous la coupe de puissances extérieures, ou bien certains pays se sont repliés sur eux-mêmes. L'Association des Nations du Sud-Est (ASEAN) est certes apparue dès 1967, mais, hier comme aujourd'hui, elle doit composer en interne avec des forces politiques centrifuges. Toutefois, une fois soldée la crise financière de 1997, la machine économique s'est emballée principalement à partir du pôle du détroit de Malacca, et il existe désormais une volonté partagée de s'enrichir en s'appuyant sur le dynamisme et la brillance des world class cities. Il en résulte un laboratoire multiculturel qui devra dépasser les tensions interreligieuses, interethniques, interrégionales...