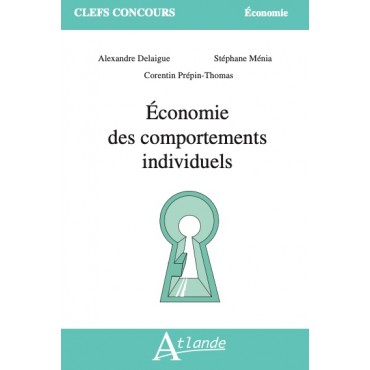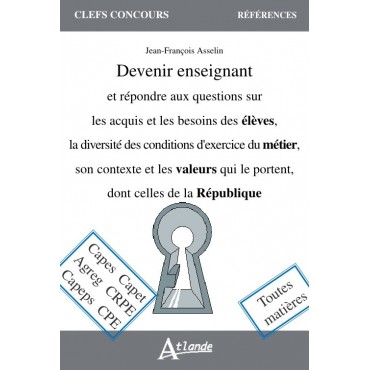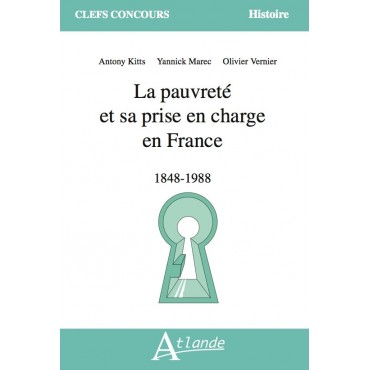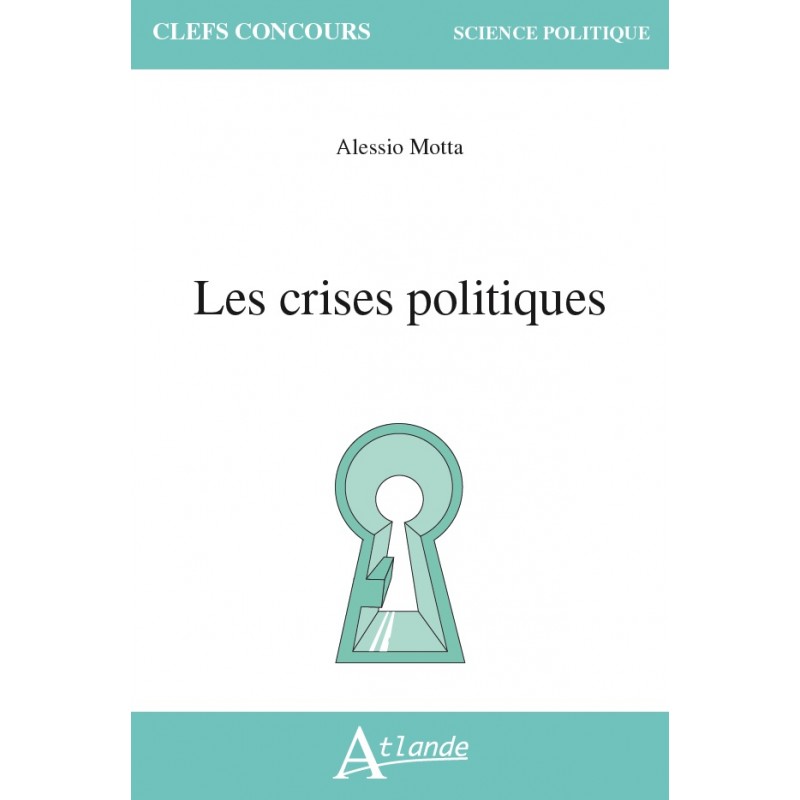
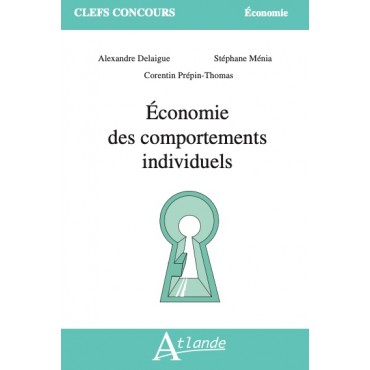
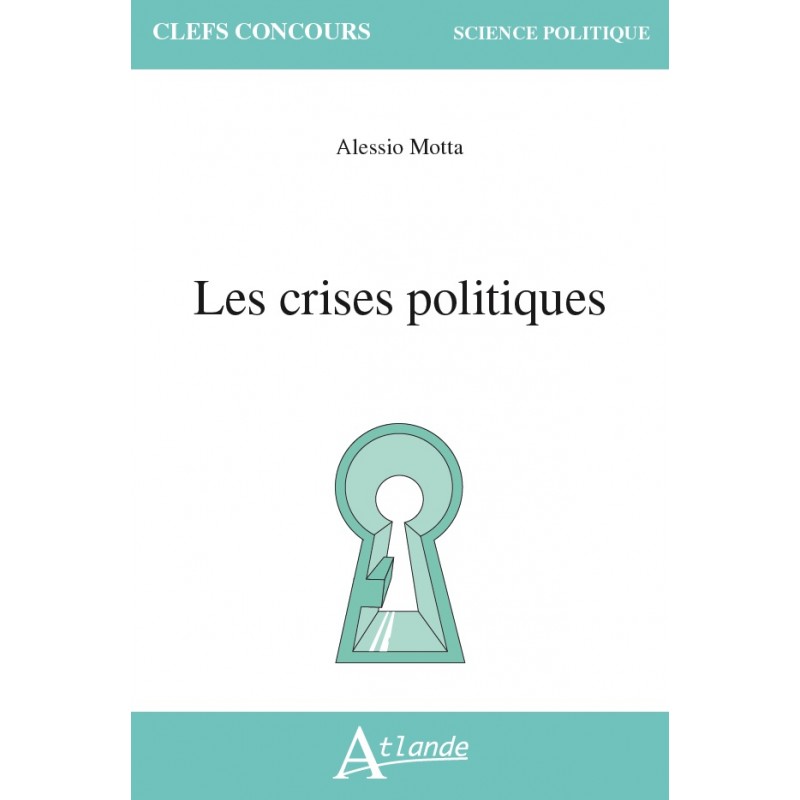
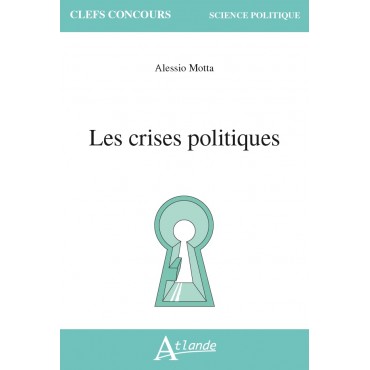
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Tout ce dont le candidat a besoin pour le sujet 2023-2024 de Science politique de l'agrégation externe de Sciences économiques et sociales, l’un des deux sujets au programme.
Comme tous les Clefs-concours, l’ouvrage est structuré en trois parties :
- Repères : un rappel des concepts et de leur histoire,
- Thèmes : comprendre les enjeux du programme,
- Outils : pour retrouver rapidement une définition, une date, une référence.
Fiche technique
Introduction
Les crises politiques, premiers éléments de définition 20
La continuité dans les crises 22
REPÈRES : Les sociétés différenciées,
terrains des crises contemporaines
Champs, autonomie relative et capitaux…
Premières notions sur les espaces sociaux
Les champs, des espaces de lutte 30
Autonomie et hétéronomie des champs 32
Les capitaux 33
Relations entre secteurs et transactions collusives
Quelques logiques des relations intra et intersectorielles 35
Transactions collusives et captation des calculs 37
Les scandales ordinaires
Stigmatisation et scandale 41
Scandale et fluidité 43
THÈMES
Les formes de dominations et leurs limites : Légitimités, constellations d’intérêts, variations et contestations
Les formes de dominations légitimes 50
Les trois types idéaux wébériens de la domination légitime 50
Types de légitimités, transformations et confusions 52
Légitimité, calculs d’intérêt et domination 54
Soutien diffus et soutien spécifique 54
Équilibrisme et limites de la domination 56
La délégitimation, cause ou produit des crises politiques ? 57
Le piège étiologique et les autres illusions de la sociologie
des crises politiques 58
Légitimité sectorielle (ou réservoirs de soutien diffus)
et effets de délégitimation induits 61
Les dynamiques générales des crises politiques : mobilisations, conjonctures fluides, interdépendance et logiques d’acteurs
Mobilisations collectives et conjonctures fluides :
cohabitation et succession des logiques 64
Coups et jeux 64
Le jeu tendu imparfait, caractéristique clé de l’interdépendance tactique élargie 68
Cadres et logiques de situations autonomes 69
Les limites des logiques de situation : habitus, captation des calculs, répertoires et anticipation de logiques externes 74
Mobilisations collectives, événements et construction des crises 76
Les caractéristiques des conjonctures fluides 84
Interdépendance tactique élargie, habitus, stratégies
et solutions typiques 87
Activité de définition de situation et construction de la crise,
de ses seuils, de ses issues… 88
Points focaux et alignement des définitions de situations 90
Quelques stratégies typiques d’issues et leurs conditions
de réussite 92
Régression vers les habitus ou obsession de l’autre ? 98
Crises et transformation de l’ordre social : les conséquences durables des crises sur les rapports sociaux
Quelques avertissements sur les révolutions et transitions 102
1989 - 2011 103
Bifurcations, transformations et construction d’une mémoire collective 108
Adaptations, gestion des crises et des risques :
entre impulsions nouvelles et continuité 111
Situations critiques, maintien de l’ordre et perte du contrôle
étatique de la violence : quelques exemples 111
La gestion internationale des crises, entre spécialisation
et désectorisation 114
OUTILS
Bibliographie 121
Glossaire 131
Index 135
Alessio Motta, enseignant-chercheur en sciences sociales et fondateur de Mobilisations.org.
L’un des points de départ du travail de Michel Dobry est de reprendre à son compte la formule de Clausewitz : “La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens” [2014 (1832)]. La crise politique s’inscrit dans la continuité de la politique ordinaire et doit donc être étudiée avec des outils qui permettent d’observer cette continuité. Ce n’est pas en parlant des grandes causes supposées expliquer une crise (le “pourquoi”) que l’on comprend celle-ci. C’est plutôt en étudiant ce qui se passe pendant cette crise (le “comment”). Bien plus qu’on ne l’imagine, d’ailleurs, pendant des périodes de crise politique où tous les repères semblent perdus, l’une des principales préoccupations d’un grand nombre d’individus est de trouver comment continuer à agir “normalement” ou de façon que les choses tournent “normalement”. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le passage au régime de Vichy a reposé en grande partie sur le travail de fonctionnaires qui, loin de prendre position sur la situation politique, réalisaient ce qu’ils considéraient comme leur mission ordinaire [Baruch, 1997]. Pendant la guerre civile libanaise (1975-1990), un grand nombre de hauts fonctionnaires devenus “autonomes vis-à-vis d’un gouvernement paralysé” ont préservé la continuité de l’État à la fois en continuant leur travail habituel et par des actions plus… borderline, qui visaient à accomplir pleinement le but officiel de l’institution dans laquelle ils travaillaient : “Préserver les bureaux des pillages au point parfois de dormir dans son administration, traverser les lignes de démarcation pour maintenir un ministère ouvert ou pour faire parvenir les salaires des deux côtés de Beyrouth, convertir son appartement en bureau provisoire : des dizaines d’ex-directeurs de ministères, hauts fonctionnaires, diplomates ou cadres d’institutions comme Électricité du Liban (EDL) racontent à l’envi ces histoires derrière lesquelles ils se sont engagés personnellement, voire physiquement.” [France, 2016 et en cours]