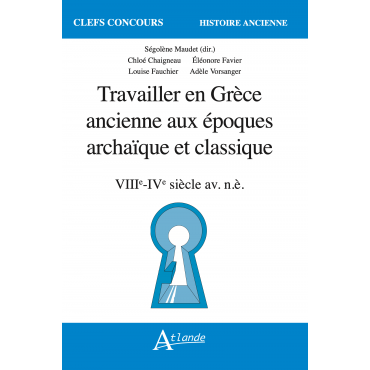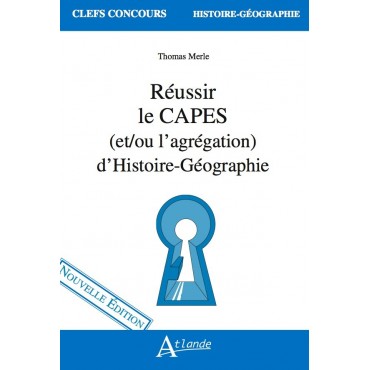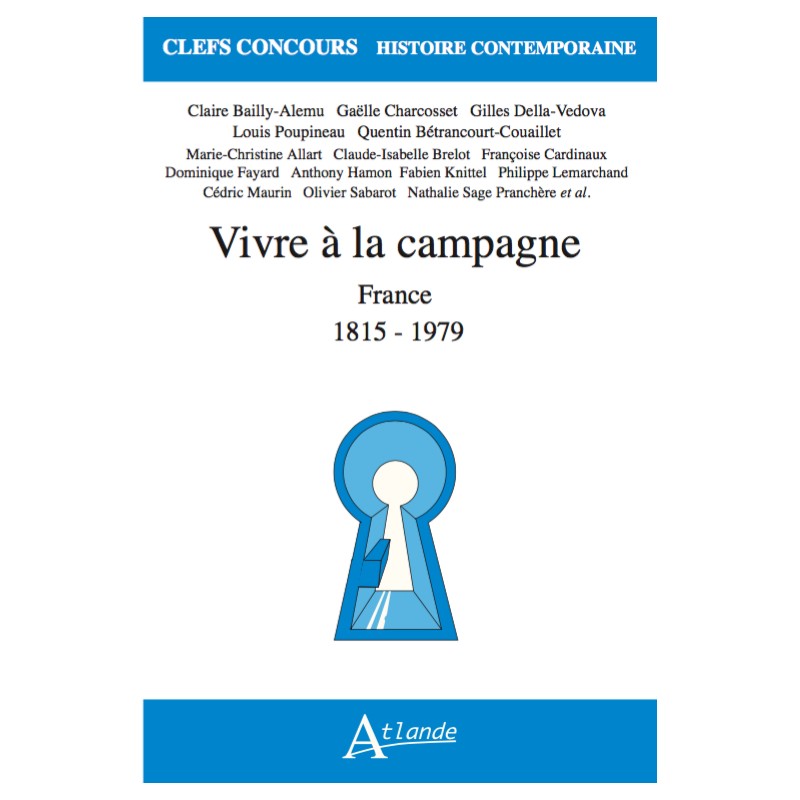
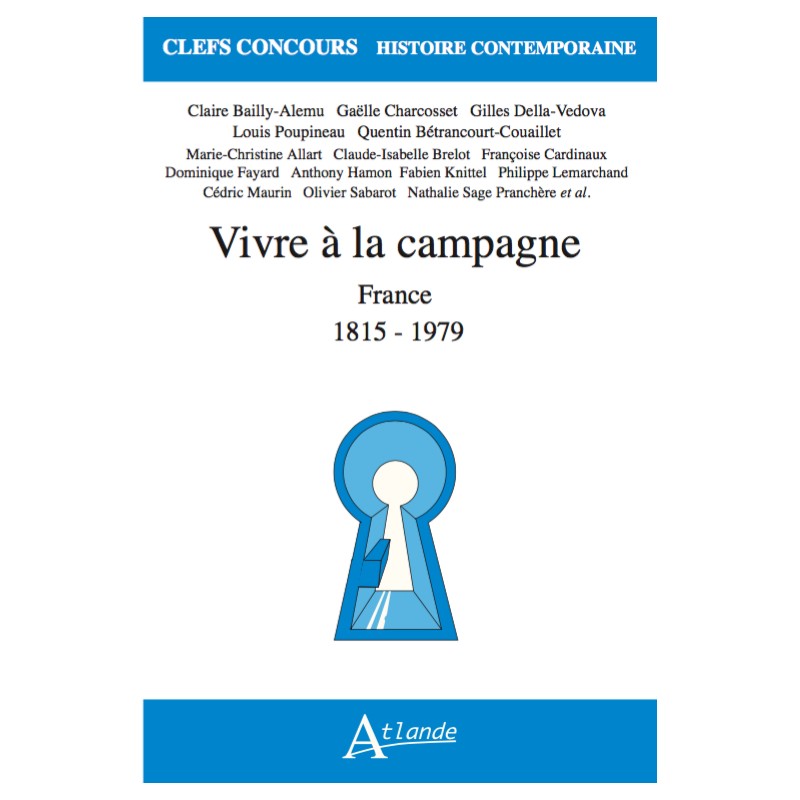
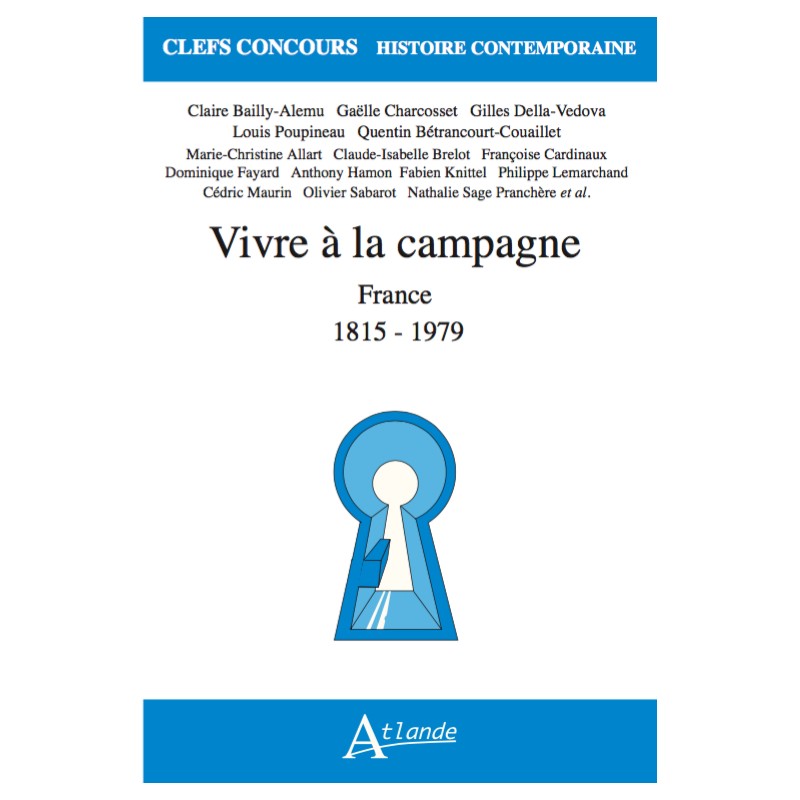
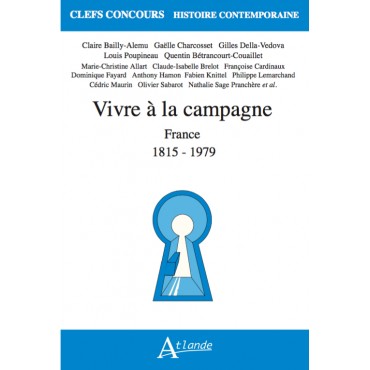
Par Collectif
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Tout ce dont l’étudiant a besoin pour le sujet 2025 d’Histoire de l'agrégation externe. Comme tous les Clefs-concours, l’ouvrage est structuré en trois parties :
- Repères : le contexte historique ;
- Thèmes : comprendre les enjeux du programme ;
- Outils : pour retrouver rapidement une définition, une date, un personnage, une référence.
Fiche technique
SOMMAIRE
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
HISTORIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
REPÈRES
LES CAMPAGNES ENTRE ORDRE ET MODERNISATION
(1815-1848)
STRUCTURES SOCIALES ET AGRAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PLAFOND DÉMOGRAPHIQUE ET AUGMENTATION DE LA PRODUCTION . . . . 33
OUVERTURE LENTE DES CAMPAGNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
LA LENTE ENTRÉE EN POLITIQUE DES CAMPAGNES . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
LE BEAU XIXe SIÈCLE DES CAMPAGNES ? (1848-1870)
LA RUPTURE DE 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MONTÉE DES PRIX, PROGRÈS RELATIFS DE L’AGRICULTURE . . . . . . . . . . . 43
DES PROGRÈS RELATIFS DANS LES MODES DE VIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CAMPAGNES ET POLITIQUE SOUS LE SECOND EMPIRE . . . . . . . . . . . . . . . 47
CRISE DE L’AGRICULTURE
ET RÉPUBLICANISATION DES CAMPAGNES (1870-1914)
LA RÉPUBLIQUE S’IMPOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
CRISE ÉCONOMIQUE ET STAGNATION DE LA PRODUCTION . . . . . . . . . . . . 53
AFFIRMATION DU SYNDICALISME AGRICOLE,
LUTTES DES MÉTAYERS ET DES VITICULTEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
DES CAMPAGNES PLUS OUVERTES SUR LA SOCIÉTÉ ENGLOBANTE . . . . . . 58
RÉPUBLICANISATION DES CAMPAGNES, HÉTÉROGÉNÉITÉ DU TERRITOIRE . 61
LES CAMPAGNES ET LE BRUIT DU MONDE (1914-1945)
LES CAMPAGNES ET LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE . . . . . . . . . . . . . . 65
TRIOMPHE DE L’EXPLOITATION FAMILIALE ET ÉVOLUTIONS DU MODE DE VIE
DANS LES CAMPAGNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
LA CRISE DES ANNÉES 1930 ET SES CONSÉQUENCES POLITIQUES . . . . . . 70
LA SECONDE GUERRE MONDIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LES CAMPAGNES
À L’HEURE DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
ET DE LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (1945-1963)
RESTRUCTURATION DE LA PAYSANNERIE APRÈS LA SECONDE GUERRE
MONDIALE ET REDÉMARRAGE DE LA PRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LE MODE DE VIE À LA CAMPAGNE
DANS L’APRÈS-GUERRE ET SES ÉVOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LIMITES DE LA “RÉVOLUTION SILENCIEUSE”
ET RECOMPOSITIONS MAJEURES DE LA VIE À LA CAMPAGNE
(1963-1980)
MODERNISATION RAPIDE DE L’AGRICULTURE
ET ÉVOLUTION DU MODE DE VIE DES AGRICULTEURS . . . . . . . . . . . . . . . 87
LIMITES ET CONTESTATIONS DU MODÈLE DE LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE . . 89
REDÉMARRAGE DE LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
DANS LES CAMPAGNES ET RECOMPOSITIONS MAJEURES . . . . . . . . . . . . . . 93
THÈMES
NAÎTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Naissance sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
• La grossesse et l’enfant réprouvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
• L’enfant et la mère insérés dans la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
• Identité et filiation aux yeux de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
• Le desserrement du contrôle social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
La médicalisation de la naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
• La diffusion de nouvelles pratiques et savoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
• Confrontations de savoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• L’achèvement de la médicalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
SE NOURRIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Évolution du régime alimentaire au cours du temps . . . . . . . . . . . 119
L’évolution des pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Nourriture et représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
AIMER, SÉDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Les hommes soumis à l’impératif de virilité . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Les femmes : convoitées, surveillées, dominées . . . . . . . . . . . . . . 132
Une ébauche d’émancipation des couples au cours du XIXe siècle . 135
Après 1918 et jusqu’aux années 1980 :
une plus grande liberté relationnelle concomitante
à la fin des sociétés d’interconnaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
SE MARIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Entre institution et contrat : un sacrement, un contrat civil,
une alliance économique, un rite de passage . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Un mariage sous contrôles familial et villageois (XIXe siècle) . . . . 143
Le mariage à l’heure de la privatisation du couple et des mobilités
intenses (fin du XIXe siècle-première moitié du XXe siècle) . . . . . . 150
Le mariage, symptôme du déclassement social des agriculteurs
(années 1950-1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
CROIRE ET PRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Des croyances et dévotions diverses
qui tendent vers l’homogénéisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Déchristianisation et renouveaux de la foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
POSSÉDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
La persistance de la petite exploitation au XIXe siècle . . . . . . . . . . 167
L’aristocratie et la bourgeoisie face à la terre . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Les enjeux économiques, politiques et culturels de la propriété . . 175
MODERNISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Les phases de la modernisation économique à la campagne . . . . . 179
• 1815-années 1880 : un “décollage agricole” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
• Années 1880-1945 : le temps des crises, un frein à la modernisation ? . 181
• 1945-années 1970 : la seconde révolution agricole . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Trajectoires et réceptions de la modernisation . . . . . . . . . . . . . . . . 186
• Le sous-développement volontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
• Le sous-développement nécessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
• Les modernités et la société rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
SE DIVERTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Fêtes et loisirs “traditionnels” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Une acculturation des loisirs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
La réinvention des loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
MIGRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
La première moitié du XIXe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Seconde moitié du XIXe siècle-1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
D’une guerre à l’autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Après-guerre : la fin des campagnes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
SE RÉVOLTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
1815-1851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
1851-1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
• Du Second Empire à l’avènement de la IIIe République . . . . . . . . . . . . 212
• Tournant du siècle : l’intensification de la lutte des classes . . . . . . . . . . 213
1918-1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
1940-1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
OUTILS
FIGURES
BOUILLEURS DE CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
COLPORTEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Des individus difficilement identifiables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Essor et déclin d’une activité à la fois commerciale et sociale . . . 227
CONSCRITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
CHASSEURS ET BRACONNIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
CURÉS DE CAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Recrutement et formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Missions et activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Le curé de campagne face à la “modernité” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
DAMES D’OEUVRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ÉLEVEURS DE BOVINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Une division des tâches dans le cycle de production des bovins . . 256
Les éleveurs naisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Les éleveurs sélectionneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Les emboucheurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Le tournant des années 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ÉLUS DES CAMPAGNES : DÉPUTÉS, SÉNATEURS,
CONSEILLERS GÉNÉRAUX, CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT . . . . . . . . 265
Une représentation de territoires
et donc une surreprésentation des campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Un personnel stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
• Trois profils sociologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
• Des éléments communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
• Stabilité sociale mais des ruptures politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Les élus des campagnes dans les hémicycles :
des intérêts bien défendus ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Du notable en politique à l’homme politique . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
ÉTRANGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Qui est l’étranger ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Le rôle de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
FEMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
De 1815 à 1914 : des ménagères largement confinées au foyer . . 289
De 1914 à 1945 :
des “gardiennes” qui acquièrent un début d’autonomie . . . . . . . . . 292
De 1945 à la fin des années 1970 :
des travailleuses en quête de reconnaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
GENS DU VOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
MAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Pouvoirs et autorité du maire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Des maires nommés (1815-1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
• Des notables ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
• La nomination : entre principes et pragmatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Une “révolution des mairies” ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
• Le symbole de la République ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
• Le maintien d’une oligarchie municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Des maires de plus en plus techniciens ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
• Une technicité de plus en plus importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
• Se constituer en groupes de pression
pour défendre les communes rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
MAQUIGNONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Oubliés de l’Histoire et insaisissables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Les vrais marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Maquignons et emboucheurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Une activité éphémère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Le financement des commerces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
MÉDECINS DE CAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Le médecin de campagne dans la littérature au XIXe siècle . . . . . . 328
1803-1892 : deux grades, docteur-médecin et officier de santé . . . 328
L’encadrement médical dans les campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
• Les évolutions de contextes d’exercice des médecins de campagne . . . 329
Le médecin de campagne,
un notable au contact des populations rurales . . . . . . . . . . . . . . . . 330
• L’exemple de Théophile Roussel (1816-1903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
• Les tournées de visites au coeur de la sociabilité dans les campagnes . . 332
NÉORURAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
NOURRICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Un mouvement qui s’inscrit dans les mobilités rurales . . . . . . . . . 336
Les nourrices actrices du développement rural . . . . . . . . . . . . . . . 339
Les nourrices dans les filets de la protection sociale . . . . . . . . . . . 343
POLICE RURALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Gardes champêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
SAGES-FEMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Former des sages-femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
• La solution à la “dépopulation” française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
• Le cadre législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
• Lieux et résultats de la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Qui sont les sages-femmes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Les racines rurales des sages-femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• L’échoppe et la boutique : les origines sociales des sages-femmes . . . . 352
• Vies ou survies de sages-femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Au service des mères et des enfants : un exercice rural exigeant . 354
• Par tous les temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
• La lutte contre la mortalité maternelle et infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
• Les maternités rurales, une institutionnalisation de la naissance
avant le “grand déménagement” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
VÉTÉRINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Les deux pieds dans la glèbe (1815-1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
À l’heure de la République et du “progrès”
(années 1880-années 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Temps de bascule (à partir des années 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
PORTRAITS
FLEURANT AGRICOLA (1864-1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
MARCELIN ALBERT (1851-1921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
MADELEINE ALLAIRE (1919-2015) :
PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA JACF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
LUCIE BAUD (1870-1913) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
RENÉ BLONDELLE (1907-1971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
JEAN-BAPTISTE BOUSSINGAULT (1802-1887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
GUSTAVE COURBET (1819-1877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
MICHEL DEBATISSE (1924-1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
JEAN-MARIE DÉGUIGNET (1834-1905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
RENÉ DUMONT (1904-2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
GEORGES DUBOEUF (1933-2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
ÉMILE DUPORT (1889-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
YVONNE GOURIOU (1899-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
LOUIS NICOLAS GRANDEAU (1834-1911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
ÉMILE GUILLAUMIN (1873-1951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
BERNARD LAMBERT (1931-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
ÉDOUARD LECOUTEUX (1819-1893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
PIERRE LE ROY (1941-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
JULES MÉLINE (1838-1925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
ÉMILIE MENDRE (1896-1985) :
PREMIÈRE SECRÉTAIRE NATIONALE DE LA JACF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
AMÉLIE MILCENT MEYSSONNIER (1875-1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814-1875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MARIE JOSEPH DE MAUNY DE MORNAY (1804-1868) . . . . . . . . . . . . . 396
MARTIN NADAUD (1815-1898) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
LOUIS-FRANÇOIS PINAGOT (1798-1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
EDGARD PISANI (1918-2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
HENRI POURRAT (1887-1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
VICTOR PULLIAT (1827-1896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
THÉOPHILE ROUSSEL (1816-1903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
FRANÇOIS TANGUY-PRIGENT (1909-1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
JEAN-MARIE VIANNEY (1786-1859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
ESPACES
LA COLONIE AGRICOLE ET PÉNITENTIAIRE DE METTRAY . . . . . . . . . . . . 405
LE COMICE AGRICOLE DE LA DOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
LES COMMUNAUTÉS RURALES JUIVES D’ALSACE . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
L’ÉCOLE PRATIQUE DE LAITERIE DE COËTLOGON . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
ACTIVITÉ DES DÉBITANTS DU CANTON DE MONTBARREY :
LE CAS DE L’ÉPICERIE DE CHARLES PETIT À MONTBARREY . . . . . . . . . 410
Une activité multiforme et non négligeable
sur la commune de Montbarrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Échanger du crédit dans un système peu ouvert
et avec peu de liquidités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Le “Général-store” de Charles-Ernest Petit,
une épicerie qui propose une grande diversité de produits . . . . . . 413
LA FERME-ATELIER :
LA TAILLANDERIE DE NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (DOUBS) . . . . . . . . . . 416
Un atelier familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Aménagement et rationalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Conquêtes commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Une authentique ruralité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Difficultés techniques et économiques (1921-1969) . . . . . . . . . . . 422
Ferme-atelier et nébuleuse proto-industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
IVRY : LA MUTATION D’UN VILLAGE EN BANLIEUE . . . . . . . . . . . . . . . . 424
LE COMMUNISME RURAL EN CORRÈZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
LE CANTON DE MOREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
LE MARCHÉ AUX BESTIAUX DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS . . . 428
De la rue au champ de foire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Un marché dédié à la vente du bétail gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Une société temporaire qui se forme chaque semaine . . . . . . . . . . 431
Un marché qui s’ouvre à la vente du bétail maigre . . . . . . . . . . . . 432
NOYANT D’ALLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
L’EXPLOITATION DE LA FORÊT DU PAYS D’OTHE . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
USINE-PENSIONNAT DE JUJURIEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
VIE QUOTIDIENNE ET SOCIABILITÉ
CHAMBRES D’AGRICULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
CHÂTEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Qu’est-ce qu’un château ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
• Typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
• Ségrégation sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
La vie de château (1820-1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
• Au fil des saisons… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
• Dans la sociabilité d’une “culture de l’entre-soi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
• Autour d’une vaste maisonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Le château et le Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Le temps des reconversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
• “Les châteaux du social” (1880-1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
• Destructions et difficultés économiques (1914-1945) . . . . . . . . . . . . . . . 458
• La fin des châteaux ? (1945-1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
• Mutations et adaptations : le château-PME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
COMICE AGRICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
L’agriculture du sol au plafond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
L’excellence agricole au ras du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
ÉLECTRICITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
ENSEIGNEMENTS AGRICOLES PAR CORRESPONDANCE . . . . . . . . . . . . . . 473
JAC-JACF / MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE . . . . . . 476
À la croisée entre crise réelle de l’Église
et crise présumée du rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Les évolutions du mouvement des années 1930 aux années 1960 . . 477
Vivre au temps de la JAC/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
MAISONS D’ENFANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
L’apparition des maisons d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
L’explosion du phénomène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
PLURIACTIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Le rôle historique de la pluriactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Des exemples de pluriactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Trajectoire de la pluriactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
SANATORIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
La tuberculose, “peste blanche” des XIXe et XXe siècles . . . . . . . . . 495
L’opposition des campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
TROUSSEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
VACHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Un maillon essentiel du monde rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Des “Machines vivantes” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Les “Vaches de la République” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
La filière laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
L’intensification de l’élevage bovin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
DOCUMENTS
LE PEUPLE DES CAMPAGNES SELON MICHELET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
DEUXIÈME LETTRE D’UN PAYSAN AUX CULTIVATEURS . . . . . . . . . . . . . . 525
CÉRÉMONIE DES LIVRÉES DANS LES NOCES DE CAMPAGNE . . . . . . . . . . 529
UNE ÉMEUTE FRUMENTAIRE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE . . . . . . . . . . . . 531
MODERNISATION ET AGRICULTURE :
TRANSFORMATION D’UN TERRAIN VAGUE EN TERRE CULTIVABLE . . . . . . 534
ROUTINE AGRICOLE DANS LE MASSIF CENTRAL
AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
UN COMICE AGRICOLE SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET . . . . . . . . . . . 537
INSTRUCTION PRIMAIRE. EST-IL AVANTAGEUX POUR L’AGRICULTURE ET
POUR LE PAYSAN QUE CE DERNIER SOIT INSTRUIT ?
PAR M. PRÉVOST, MEMBRE NON RÉSIDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
RÉPONSES DU COMICE DE LILLE À L’ENQUÊTE AGRICOLE DE 1866 . . . 546
LES CAMPAGNES DU VAR CONTRE LE COUP D’ÉTAT, VUES PAR ZOLA . . 554
SUR L’EXODE RURAL, POINT DE VUE D’UN CURÉ RESTÉ SUR PLACE . . . 557
PLURIACTIVITÉ DES POPULATIONS RURALES DE BASSE-PROVENCE . . . . 559
L’ASSÈCHEMENT DES LANDES DE GASCOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
UN MARCHÉ AUX BESTIAUX VU PAR ZOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
UN FOLKLORE EN DANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
LA COMMUNE RURALE VUE PAR HIPPOLYTE TAINE . . . . . . . . . . . . . . . . 571
LA PROPAGANDE SOCIALISTE DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES . . . . . 575
LA QUESTION DE L’ÉCOLE
DANS UNE FAMILLE PAYSANNE DU XIXe SIÈCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
LES LENTS PROGRÈS DE L’INSTRUCTION DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
LES GRÈVES AGRAIRES EN FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
LA VIE PAYSANNE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
TRADITION ET MODERNITÉ DE LA VIE RURALE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE . 586
DES PAYSANS ITALIENS DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE
DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
LE QUOTIDIEN D’UN OUVRIER AGRICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
L’ENFANCE À LA CAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
L’ÉTAT ET LES PAYSANS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
LA VIE D’UN JEUNE ADULTE À LA CAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
CHRONOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611
CARTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667
INDEX ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .681
Marie-Christine Allart est docteure en histoire, professeure agrégée d’histoire-géographie et chercheuse rattachée à l’IRHiS (université de Lille3). Elle est spécialiste du monde agricole du Nord-Pas-de-Calais.
Mona Alziary est normalienne formée en sciences humaines, économiques et sociales.
Claire Bailly-Alemu est professeure en lycée professionnel, docteure en histoire contemporaine, membre associée du Laboratoire d’études rurales (LER-Serec), Université de Lyon.
Quentin Bétrancourt-Couaillet est diplômé d’un master de recherche en sciences politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence.
Claude-Isabelle Brelot est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Lyon 2 (Laboratoire d’études rurales), spécialiste de l’histoire des noblesses pendant la Révolution, de l’histoire rurale aux XIXe et XXe siècles ainsi que de la proto-industrialisation rurale.
Françoise Cardinaux est doctorante en histoire à l’Université Bourgogne-Franche-Comté en troisième année et professeur.
Gaëlle Charcosset est professeure d’histoire-géographie dans l’académiede Dijon et membre associée du Laboratoire d’études rurales(LER). Elle a soutenu sa thèse de doctorat en histoire Le politique au village. Histoire sociale de l’institution municipale, 1800-1940. Arrondissement de Villefranche (Rhône), à l’université de Lyon en 2018.
Gilles Della-Vedova est agrégé d’histoire-géographie et docteur en histoire. Sa thèse a été publiée aux Presses universitaires de Grenoble en 2020 sous le titre La montagne des possibles. Les acteurs du développement rural (Villard-de-Lans XIXe-XXIe siècles). Enseignant d’histoire en filière A/L en CPGE au lycée du Parc (Lyon), membre associé du Laboratoire d’études rurales (Lyon 2), il intervient également au sein du département d’histoire de l’Université Grenoble Alpes (UGA).
Dominique Fayard est docteure en histoire et consacre ses recherches aux acteurs de la filière bovine charolaise aux périodes moderne et contemporaine (éleveurs, emboucheurs, négociants en bestiaux, coopératives), aux pratiques commerciales et lieux d’échange, à la formation du paysage de bocage et à l’architecture vernaculaire en lien avec les activités agricoles.
Anthony Hamon est docteur en histoire contemporaine, professeur dans l’enseignement secondaire, chargé de cours à la préparation de l’agrégation externe à Sciences Po Paris et à l’université Rennes 2. Il est membre associé du laboratoire Tempora et siège au conseil d’administration de l’Association d’histoire des sociétés rurales. Sa thèse intitulée Instruire et interroger l’identité agricole de la France. L’enquête sur la situation et les besoins de l’agriculture (1866- 1870), a été soutenue en 2023.
Fabien Knittel est maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté (Centre Lucien Febvre) et secrétaire général-adjoint de l’Association d’histoire des sociétés rurales. Il est notamment l’auteur des ouvrages Agronomie et techniques laitières. Le cas des fruitières de l’Arc jurassien, 1790-1914 (Classiques Garnier, 2021) et La Fabrique du lait. Europe occidentale (CNRS éditions, 2023). Il a récemment codirigé (avec Corinne Marache et Stéphanie Lachaud) Sciences, techniques et agriculture. Des Lumières au XXe siècle (Presses universitaires de Bordeaux, 2024).
Philippe Lemarchand a été correspondant de la BBC, enseignant à Queen Mary College à Londres et à Westminster University ainsi que maître de conférences à Sciences Po Paris. Il a notamment dirigé Nourrir les hommes, un dictionnaire (Atlande).
Cédric Maurin est doctorant en histoire contemporaine à Sorbonne Université et s’attache à la biographie de Théophile Roussel (1816- 1903). Il enseigne dans le secondaire depuis 2014 et est actuellement en poste dans l’académie de Montpellier. Il a notamment contribué aux ouvrages Les Quarante-huitards et les autres. Dictionnaire des dirigeants de 1848 (Sorbonne Université Presses, 2024) et Les Dix décisives 1869-1879 (PUR, 2021).
Marina Mayer est diplômée d’études slaves de la Sorbonne Université.
Pierre Ménart est diplômé de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de l’ENS Lyon en histoire de la pensée politique.
Louis Poupineau est ancien élève de l’ENS de Lyon, agrégé d’Histoire et doctorant en histoire contemporaine à l’Université Clermont Auvergne.
Olivier Sabarot est docteur en histoire. Sa thèse soutenue à l’Université Lyon 2 en 2012 porte sur les sexualités et les pratiques sexuelles en Saône-et-Loire et dans le Rhône entre 1810 et 1940.
Daniel Séchard est un ancien élève en CPGE A/L spécialité Lettres Modernes, diplômé d’un double master de recherche Littérature et Philosophie aux Sorbonne Panthéon (Paris 1) et Sorbonne Nouvelle (Paris 3).
Nathalie Sage Pranchère est archiviste-paléographe, agrégée d’histoire et chargée de recherche au CNRS.
Nous avons tous un père, un grand-père ou un arrière-grand-père
paysan. La France est restée un pays rural bien plus tardivement que
ses voisins anglais, allemand ou du Benelux. Ce lien à la ruralité est
consubstantiel de la façon dont nombre d’étrangers nous perçoivent :
un pays où l’on apprécie les bonnes choses, la bonne chère, où l’on
prend le temps de vivre. La France s’est longtemps enorgueillie d’être
le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires et, face à
la crise du pétrole des années 1970, elle brandit son “or vert” comme le
meilleur moyen de gagner les dollars indispensables à l’achat de
l’or noir.
L’affiche de campagne de François Mitterrand en 1981 avait pour
fond un village typiquement français et pour slogan “La force
tranquille”. Certains y virent un relent du credo maurrassien suivant
lequel “la terre ne trompe pas”. D’autres, avec son église au centre de
l’image, un message subliminal de réconciliation des laïcards et des
catho-sociaux. D’autres encore, avec sa coloration bleu-blanc-rouge
très nationaliste, une ultime tentative de séduction du centre-droit pour
qu’il s’accorde le droit de voter à gauche. Le publiciste Jacques
Séguéla, qui avait conçu cette campagne, raconte que l’affiche n’était
pas politique mais sociologique, “qu’il ne s’agissait plus d’opinion
publique mais d’affection publique”.
Nous y sommes, s’il y a une France “éternelle”, “inébranlable”,
elle se doit d’être rurale. Pour faire un lien avec le précédent
programme de l’agrégation et pour paraphraser le président Sarkozy
qui s’exprimait à propos de l’Afrique, certains semblent penser que
“la campagne n’est pas encore entrée dans l’Histoire”. On aime à croire
que les sociétés rurales sont immuables ; porteuses de valeurs ancestrales,
elles constitueraient un refuge face à la modernité. Or, si l’on
considère la longue période qui s’étend de 1815 à 1979, rien n’a sans
doute plus changé que le monde rural. Longtemps angle mort de
l’Histoire de la France du XXe siècle, les trajectoires des mondes
agricoles et ruraux, de leurs communautés et de leurs acteurs sont
riches d’enseignements.
Le présent volume, fruit d’un travail pluriel d’auteurs d’horizons
variés, propose non seulement comme attendu une synthèse des évolutions
à l’oeuvre et de l’évolution de leurs perceptions, mais aussi une
foultitude d’exemples concrets, de figures, d’individus et d’espaces.
Parce que science n’a pas de prise sur la mémoire sans joie,
on y découvrira des pratiques que l’on pourra considérer en 2025
comme édifiantes, telle celle du trousseau, insolites comme le flottage
du bois, ou inédites à l’instar de l’invention du beaujolais nouveau.
L’ouvrage propose également une trentaine de documents qui donnent
chair au propos et une centaine de définitions éclairantes,
de la paillade* au noir animal*, du toucheur* au chevillard*.
J’espère que le lecteur aura autant de plaisir à lire cet ouvrage que
nous en avons eu à le composer et que le candidat saura y trouver le
“biscuit” qui le nourrisse.