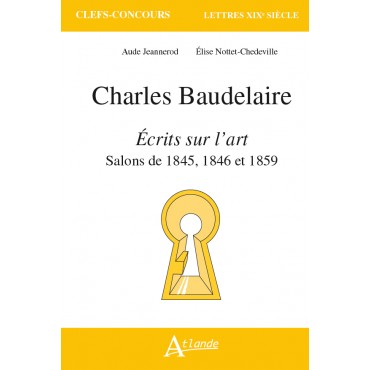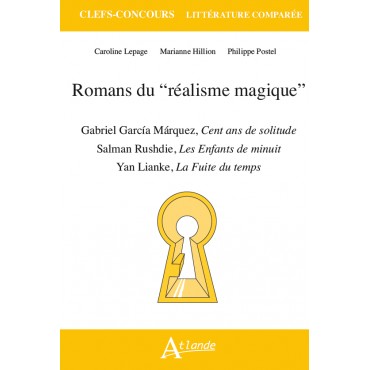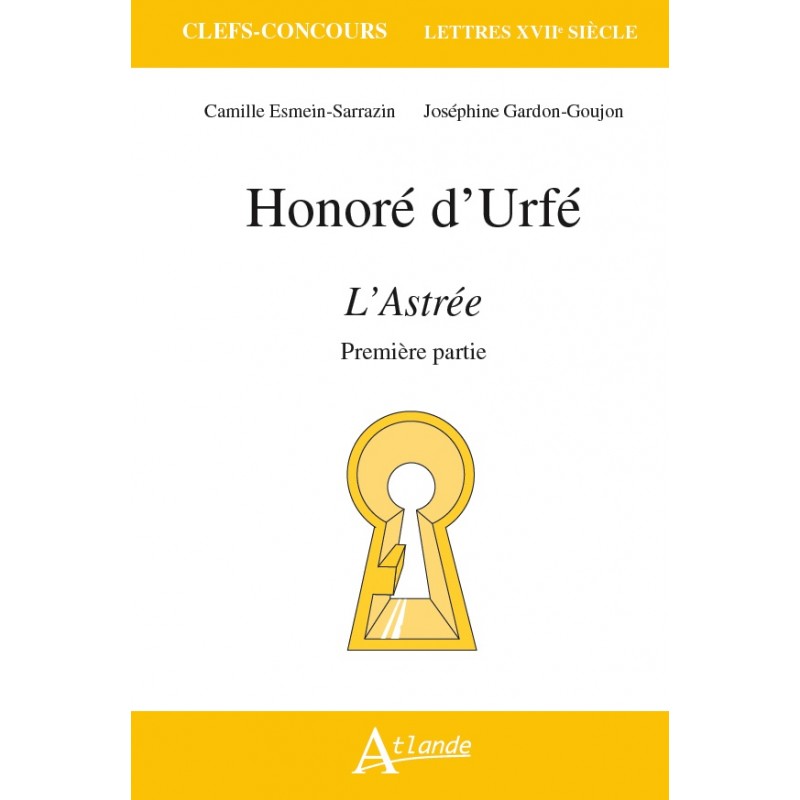
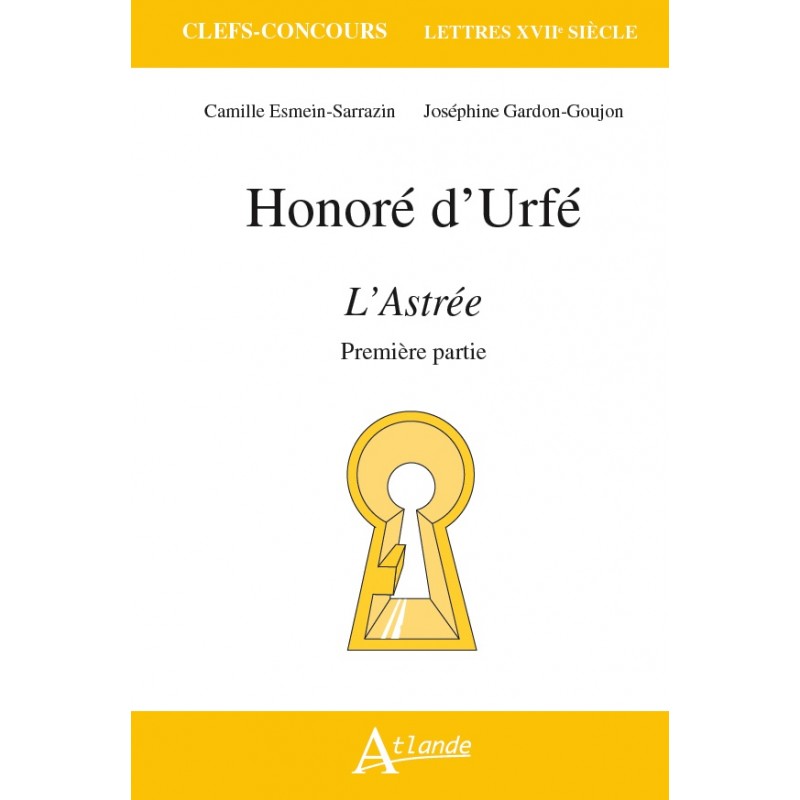
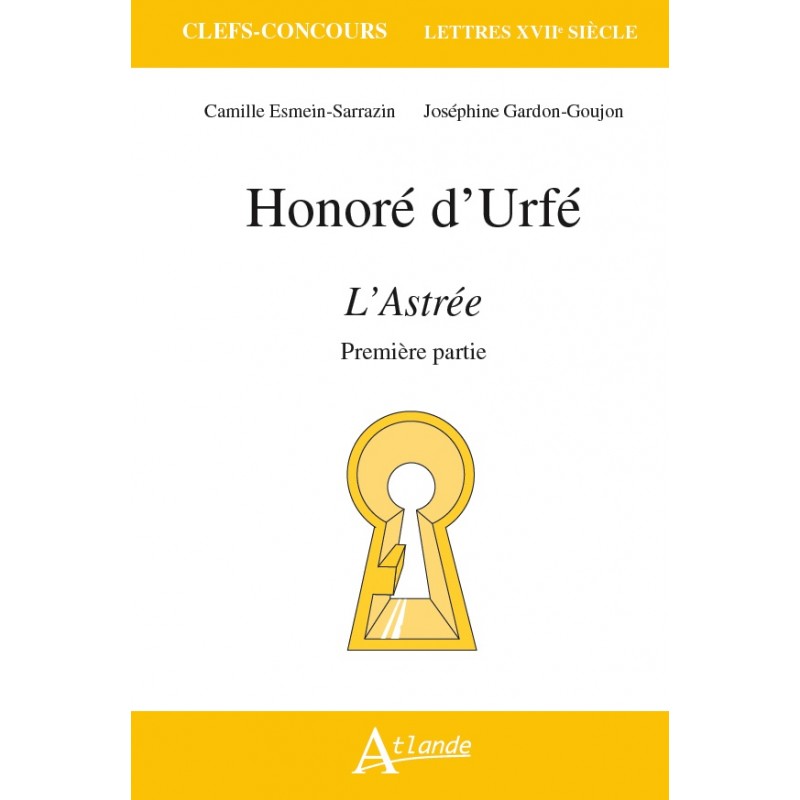
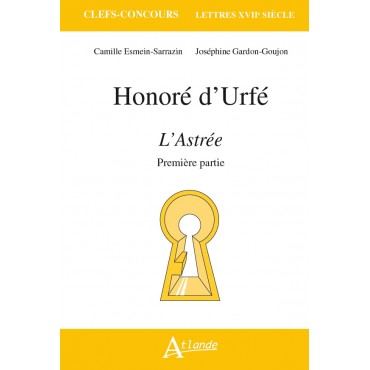
par Camille Esmein-Sarrazin et Joséphine Gardon-Goujon
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Traitant de l’œuvre d’Honoré d’Urfé au programme 2024 des agrégations externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.
Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :
Fiche technique
REPÈRE
HONORÉ D’URFÉ, LIGUEUR ET HOMME DE LETTRES
REPÈRES BIOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
UNE ŒUVRE PLURIELLE
Les Épîtres morales
La Savoysiade
La Sylvanire
LE ROMAN AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE
LES MODÈLES ANTIQUES
LE ROMAN CHEVALERESQUE ET LE ROMANZO ITALIEN
LA PASTORALE, DE L’ANTIQUITÉ AUX RÉCITS ESPAGNOLS ET ITALIENS
LE ROMAN SENTIMENTAL ET LE REFUS DU ROMANESQUE
L’ASTRÉE, “UN ROMAN QUI EST TOUS LES ROMANS”
UNE HISTOIRE ÉDITORIALE COMPLEXE
Un roman inachevé
Deux entreprises concurrentes de continuation
TRAME NARRATIVE ET INTRIGUE PRINCIPALE
Résumé de l’intrigue chez Urfé
Résumé de l’intrigue chez Baro et Gomberville
COMPOSITION DU ROMAN, HISTOIRES INSÉRÉES ET ENJEUX ROMANESQUES
“SAVOIR SON ASTRÉE” : LE BRÉVIAIRE DES COURTISAN
PROBLÉMATIQUES
L’ARCHITECTURE DE LA PREMIÈRE PARTIE
LE PARATEXTE
Épîtres
Tables
UNE COMPOSITION ENTRE COHÉRENCE ET DIVERSITÉ, AMPLIFICATION ET CONTREPOINT
L’intrigue principale
Les histoires enchâssées
Les micro-récits
Tableau récapitulatif des histoires enchâssées
STRUCTURE NARRATIVE ET ART DU CONTAGE
LES VOIX NARRATIVES
Le narrateur principal
Les narrateurs personnages
LES OUTILS DE LA NARRATION
Cohésion et maîtrise de l’information
Cohérence et temporalité interne au récit
LES ORNEMENTS DU RÉCIT
Poésies
Lettres
Sentences
PERSONNAGES ET DÉGUISEMENTS
UN MONDE DE BERGERS
La vie pastorale
Quelques figures de bergers
LES NYMPHES ET LES CHEVALIERS
Rites et institutions
Rang et condition
DÉGUISEMENT, ARTIFICE ET TRAVESTISSEMENT
Un procédé topique au rôle central
Le travestissement : construction et enjeux : le rôle des prolepses
L’AMOUR
DÉFINITIONS ET DÉBATS
La réflexion néoplatonicienne
L’amour courtois et le service amoureux
L’amour chrétien et la charité
LES LOIS DE L’AMOUR
La fidélité
La discrétion
Des services au sacrifice
AMOUR ET ROMANESQUE
Procédés et subterfuges
Cours d’amour et gageure
Jalousie et mélancolie amoureuse
Mariages heureux et malheureux
Amour et désir
Amour et amitié
RELIGION, MAGIE ET MERVEILLEUX
MERVEILLEUX ET SURNATUREL
La déesse Astrée et l’âge d’or
La fontaine de la Vérité d’amour Fortune et hasard
LA TROMPERIE DE CLIMANTHE : RELIGION ET MAGIE
LA RELIGION : CHRISTIANISME, SYNCRÉTISME ET CROYANCES PAÏENNES
Le statut de la religion dans L’Astrée
Les oracles
HISTOIRE ET POLITIQUE
UN ROMAN HISTORIQUE ?
La matière historique et son insertion dans le roman
L’arrière-plan historique : le règne de Mérovée
L’usage de l’histoire : romanesque et couleur du passé
Géographie et savoir historique
UN ROMAN GUERRIER ?
Chevalerie et réalisme historique
Héroïsme chevaleresque : realia et romanesque
UNE RÉFLEXION SUR LE POUVOIR POLITIQUE
LECTURE ET DÉCHIFFREMENT : EKPHRASIS ET ILLUSION
“L’HISTOIRE DE DAMON ET DE FORTUNE” : NARRER PAR L’IMAGE
L’ILLUSION ET LE TROMPE-L’ŒIL
UN ROMAN À CLEFS ?
TRAVAIL DU TEXTE
LEXICOLOGIE
ARCHAÏSMES, SIMPLIFICATIONS ET MODERNISATIONS
LES NOMS ABSTRAITS
LES BINÔMES SYNONYMIQUES ET L’ANTONYMIE CONTEXTUELLE
Les binômes synonymiques
L’antonymie
L’antithèse synonymique
L’ONOMASTIQUE
ÉTUDE LEXICALE DE “CIVILITEZ”
Description morphosyntaxique de l’occurrence
ÉTUDE LEXICALE D’AFFAIRE
ÉTUDE LEXICALE DE SYNTHÈSE : LA PRÉFIXATION (P. 141-142)
SYNTAXE ET GRAMMAIRE
CONSEILS GÉNÉRAUX
DE QUELQUES SPÉCIFICITÉS SYNTAXIQUES
L’omission des articles
La position du pronom clitique complément d’un infinitif régime
Les pronoms adverbiaux y et en
Souplesse des constructions verbales et propositionnelles
LES MODES NON PERSONNELS
Formes et emplois du participe
Formes et emplois du gérondif
Spécificités du participe et du gérondif dans L’Astrée
Formes et emplois de l’infinitif
LES TYPES DE PHRASE
La modalité assertive
La modalité volitive ou jussive
Modalité interrogative
Modalité exclamative
LA NÉGATION
La négation exprimée par un seul morphème
La négation exprimée par plusieurs morphèmes
LES TYPES DE PHRASES : LES RÉAMÉNAGEMENTS COMMUNICATIFS
Les types de l’impersonnel
Les types du passif
Les types de l’emphase
L’ENDOPHORE
L’endophore pronominale
L’endophore nominale
Autres types d’endophores
STYLISTIQUE
UNE LANGUE PASTORALE ?
UNE LANGUE ENTRE BAROQUE ET ÉPURE
Le goût du paradoxe et les figures d’opposition
Une syntaxe complexe ?
LES ANALOGIES
Un style “chemin faisant” : le sermo pedestris .
Un style au fil de l’eau ? les analogies élémentaires
La démétaphorisation
L’ÉNONCIATION DANS L’ASTRÉE
L’hétérogénéité énonciative
• La présence d’un je narrant : l’identité narratoriale
• Des personnages narrateurs : les récits intercalaires
• L’importance des discours rapportés dans le roman
• Les discours de l’intériorité
• La multiplication des instances réceptrices
Une énonciation valorisant la subjectivité
• Les marques d’une oralité où abondent les sentiments
• Les mots subjectifs et objectifs
• La syntaxe émotive
Emphase et expressions hyperboliques
• Les degrés de l’intensité
• Les consécutives intensives
• Les indéfinis hyperboliques
• Les comparatifs et superlatifs au service de l’emphase
• Le superlatif relatif
• Superlatifs, comparatifs et expressivité
La casuistique amoureuse ou l’héritage rhétorique au sein de L’Astrée
• Les modalités et les modalisations
• Un style différencié ?
LA STRUCTURE ET L’ORGANISATION TEXTUELLE
L’efficacité organisationnelle : l’influence de la dispositio
La progression d’un texte narratif
La cohésion du texte
La concaténation ou la construction des dialogues
• Continuité et progression : les répétitions
• Les lois du discours
• Les interjections et la conjonction puisque comme outils de la concaténation
LA CARACTÉRISATION ET LA DESCRIPTION
La caractérisation
La description
LES FORMES INSÉRÉES
Les poèmes insérés
• Le sonnet
• Les madrigaux
Les stances et l’expression de la déploration
• Stances élégiaques
• Stances rhétoriques
• La chanson d’Hylas, ou la célébration de la variété
Les histoires insérées
Les éléments détachés par les guillemets et les énoncés sentencieux
• Entre intégration et distinction : des outils rhétoriques risquant l’artifice
• Caractéristiques des énoncés sentencieux
BIBLIOGRAPHIE
Camille Esmein-Sarrazin est maîtresse de conférences à l’Université d’Orléans.
Joséphine Gardon-Goujon est docteure en littérature française et enseignante en lycée
MERVEILLEUX ET SURNATUREL
La déesse Astrée et l’âge d’or
La bergère Astrée est, comme la nymphe Galathée, dotée d’un nom mythologique. Les mythographes font d’Astrée la fille de Zeus et de Thémis. Astrée, qui est la déesse de la justice, est associée à la paix. À l’époque hellénistique, puis chez Ovide et Virgile, il est fait référence à Astrée, déesse associée à l’âge d’or ou au mythe des origines de l’humanité. Dans les Métamorphoses, la vierge Astrée s’indigne du comportement des hommes et choisit de regagner le monde des dieux. Virgile, dans les Bucoliques (IV, 5), fait d’Astrée une vierge qui annonce le retour de l’âge d’or et accompagne Saturne. Il y associe âge d’or et monde pastoral.
Dans la deuxième partie du roman, le nom d’Astrée est mis en avant notamment lorsque Céladon érige à la demande d’Adamas un temple qui associe la déesse et la bergère. Dans ce Temple d’Astrée, la déesse est représentée avec les attributs d’une bergère. Céladon voue ainsi à Astrée un culte qui semble réunir et même confondre la déesse et la bergère, comme on le voit dans les vers qu’il y laisse et qui se terminent ainsi : “Voicy le bois où chaque jour, / Un cœur qui ne vit que d’Amour, / Adore la Déesse Astrée” [L’Astrée. Deuxième partie, l. 5, p. 237].
L’époque de la publication des deuxième et troisième parties correspond à un retour à l’ordre après les troubles liés aux guerres de Religion. Or le cadre du roman, tel qu’il est mis en place dès l’incipit de la première partie, relève de l’âge d’or: le Forez serait une relique du “premier siecle”, et les bergers qui le peuplent n’ont rien à envier à ceux qui vivaient durant cette période “pour la bonté de l’air, la fertilité du rivage & leur douceur naturelle” (p. 118-119). Lieu de délices idéal tel que le définit la tradition littéraire, ou locus amoenus, le cadre du roman emprunte ainsi à la tradition de la pastorale académique et introduit la réflexion platonicienne sur l’harmonie universelle qui réapparaît ensuite régulièrement dans le roman. En effet, la description du Forez, si elle est en partie réaliste et s’appuie sur la topographie telle qu’elle a été établie par les contemporains d’Urfé et en particulier par son frère, est aussi l’objet d’aménagements qui permettent d’en faire le lieu idéal d’une nouvelle Arcadie (v. Histoire et politique, Un roman historique ?).