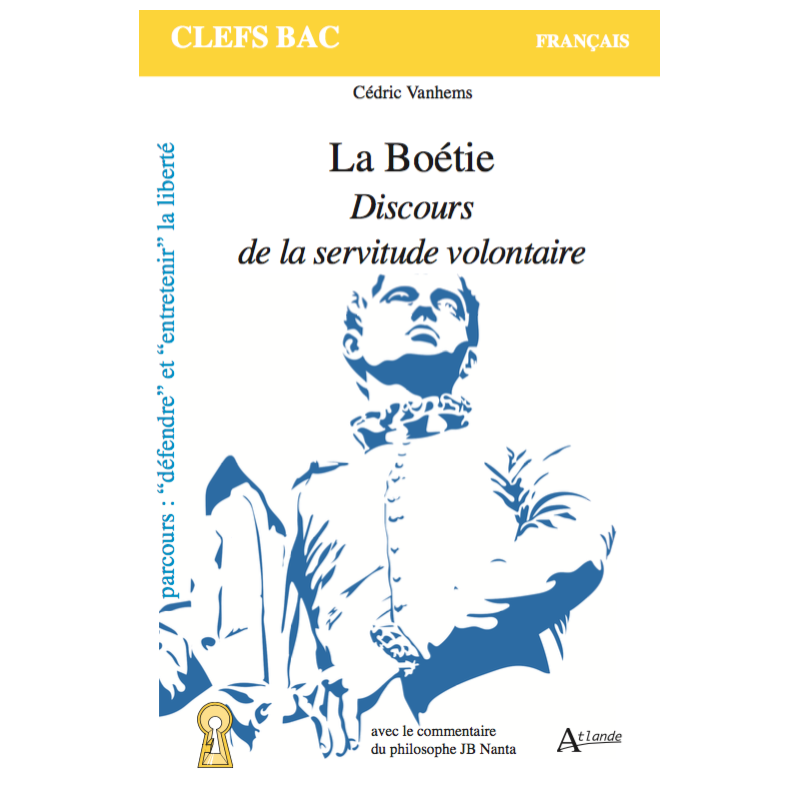
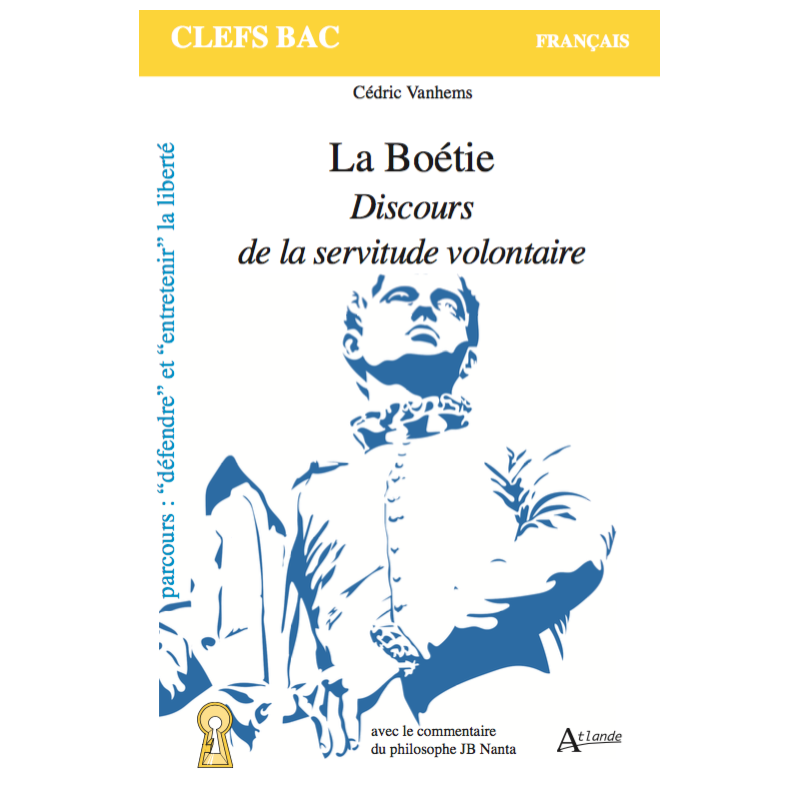
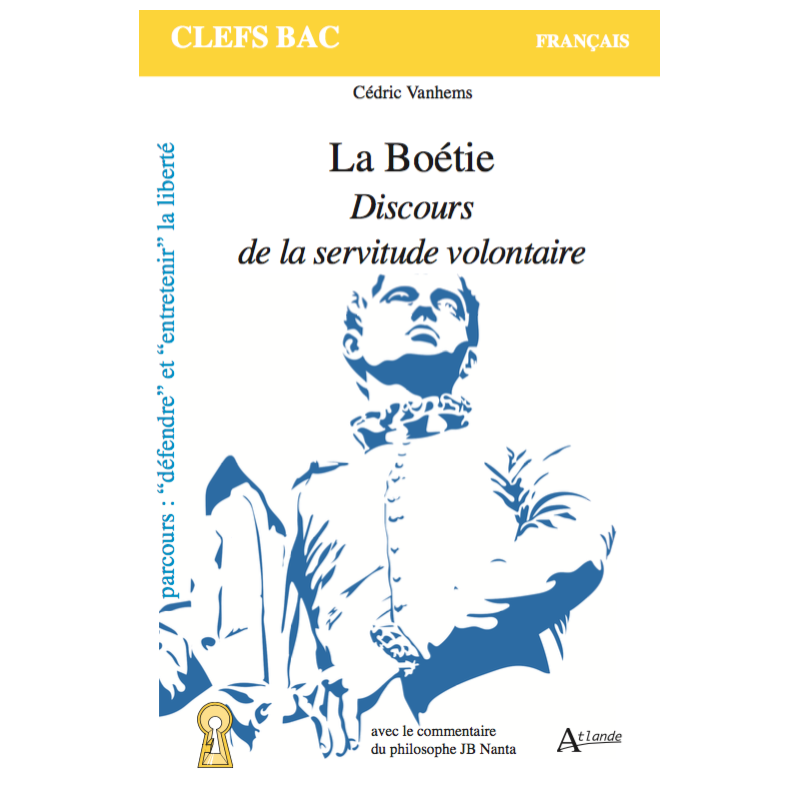
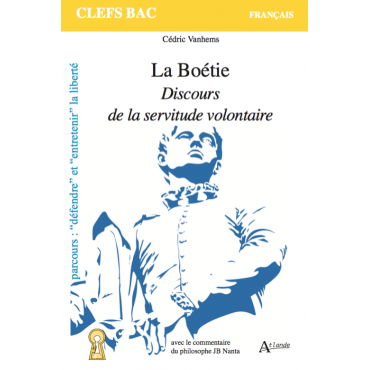
Par Cédric Vanhems
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Traitant de l’une des trois nouvelles œuvres au programme du bac de français pour les sessions 2025, 2026 et 2027, cet ouvrage offre un dossier complet et maniable dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs.
Cet ouvrage propose les éléments permettant, soit de faire cours sur le sujet, soit d’exceller dans la matière. Il se distingue donc nettement des volumes utilitaires autour des programmes.
Des QRcodes renvoient à des lectures différenciées des mêmes passages afin de faire prendre conscience au candidat des enjeux de la lecture.
Comme tous les Clefs bac, l’ouvrage comporte quatre parties :
• Morphosyntaxe du verbe
Présentation définitive
Fiche technique
Sommaire
REPÈRES
Biographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Contexte historique et politique . . . . . . . . . . . . . . . 17
La monarchie absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Les Parlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Les guerres de Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Contexte intellectuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
La Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
L’ascension des milieux juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Montaigne et La Boétie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PROBLÉMATIQUES
L’histoire d’un texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
“Une œuvre ésotérique” . .................. . . . . . . . . 35
Ce qu’en dit Montaigne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
L’introuvable acte de naissance du DSV . . . . . . . . . . . . . . . . 38
La réception du DSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Du Discours aux Essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
“Par manière d’exercitation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Le DSV, un OLNI : objet littéraire non identifié ? . . . . . . . . 45
L’héritage de la rhétorique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Situation d’énonciation et statut éthique . . .. . .. . . . . . . . 47
Une “défense et illustration” ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Inventio, dispositio, elocutio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Une rhétorique passionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Servitude et liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
L’héritage antique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Les specula principis ou miroirs des princes . . . . . . . . . . . . 72
Un “concept inconcevable” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Archéologie de la servitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Les figures du tyran et de la liberté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
“Nous savons après tout les malheurs de notre âge” . . . . . . 84
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
La question à JB Nanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Un manifeste humaniste ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Présence de l’antique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Histoire et exempla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Le sens de l’histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Nature, coutume, éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Avant La Boétie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Nature et servitude dans le DSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Amitié et avarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
L’amitié politique : un idéal humaniste et chrétien . . . . . . 113
L’amitié dans le DSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Avarice et cruauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
La question à JB Nanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
“Un” et les autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
“Un” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Le “peuple”, le “populaire” et le “populas” . . . . . . . . . . . . 134
Les “tyranneaux”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Les “gens de bien”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Défendre et entretenir la liberté . . . . . . . . . . . . . . 145
La question à JB Nanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
PARCOURS
Parcours 1 Liberté et servitude . . . . . . . . . . . . . . . 153
Henri de Mesmes, Contre La Boétie
(éd. N. Gontarbert, Gallimard, 1993) . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pascal, Pensées, 1670, posthume
(éd. Ph. Sellier, 91 & 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Rousseau, Du Contrat social, livre I, chapitre I (1762) . . . 159
Marat, Les Chaînes de l’esclavage, 1774 . . . . . . . . . . . . . . . 162
Parcours 2 : L’éducation et la culture. . . . . . . . . . . 167
Guillaume Budé, L’institution du prince
(1518-1519, publié de façon posthume en 1547) . . . . . . . 167
Voltaire, De l’horrible danger de la lecture (1766) . . . . . . . 171
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique
des progrès de l’esprit humain (1795, posthume). . . . . . . . 174
Parcours 3 : L’amitié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Montaigne, Essais, 1, 28, “De l’amitié” (1580) . . . . . . . . . 177
La Fontaine, “Les deux amis” (Fables 8, 11 – 1678) . . . . . 181
La Bruyère, Les Caractères, “Du cœur” (1688). . . . . . . . . . 184
OUTILS
Plan détaillé de La Servitude Volontaire . . . . . . . . 191
Exorde – § 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Proposition – § 3 jusqu’à “endroit inhumain et sauvage” . 191
Narration et amplification –
§ 3 (depuis “La faiblesse d’entre nous hommes”) – § 10 . . 192
1ère partie de la confirmation – § 11-18. . . . . . . . . . . . . . 193
2e partie de la confirmation :
les fruits de la servitude – § 19-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3e partie de la confirmation : l’ambition – § 25-33 . . . . . . 195
Péroraison – § 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Méthodologie de l’écrit de dissertation . . . . . . . . . 197
L’introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
L’annonce du plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Les transitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
La conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
La nature de l’épreuve orale
(partie mettant en jeu le texte) . . . . . . . . . . . . . . . 205
Les étapes de l’oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
La lecture expressive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
L’explication linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Cédric Vanhems est agrégé de Lettres classiques et de Grammaire et enseignant en Lettres au lycée Saint-Jean de Passy. Il a déjà publié le clef-bac Corneille aux éditions Atlande.
Pour montrer le caractère extravagant du lien de servitude qui unit un homme à un autre, et ainsi rendre plus manifeste le caractère paradoxal d’un tel état, La Boétie entend faire la démonstration suivante: la servitude n’est pas naturelle, elle est même son opposé. Allons plus loin avec lui : la servitude dénature l’homme, c’est-à-dire le fait déchoir de son état naturel pour le ravaler à celui d’un être plus vil et plus indigne. Si l’on entend par nature les propriétés qu’un être tient de sa naissance par opposition à celles qu’il peut acquérir par la suite, c’est-à-dire ce qui chez l’homme est inné et non acquis, autrement dit, ce qui est le propre de l’homme, ce sans quoi il ne saurait être pleinement homme, le propos de La Boétie est clair: le propre de l’homme est de vivre libre.
Cependant, même si cette affirmation nous paraît aller de soi, à nous modernes qui ne connaissons plus l’es- clavage, elle n’a pas toujours eu ce caractère d’évidence. Il est vrai, bien entendu, que l’esclavage n’existe pas en Europe à l’époque de La Boétie. Toutefois, même s’il emploie le terme de servitude dans un sens volontaire- ment provocateur, il doit affronter toute une tradition qui légitimait ou donnait des raisons au fait social qu’est l’esclavage.