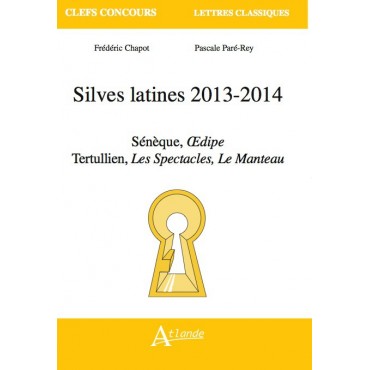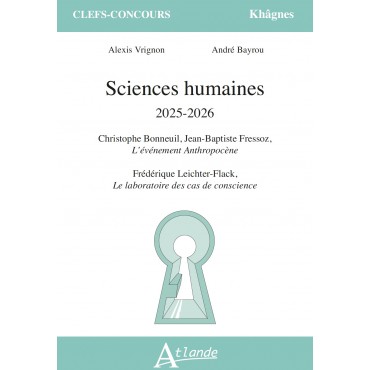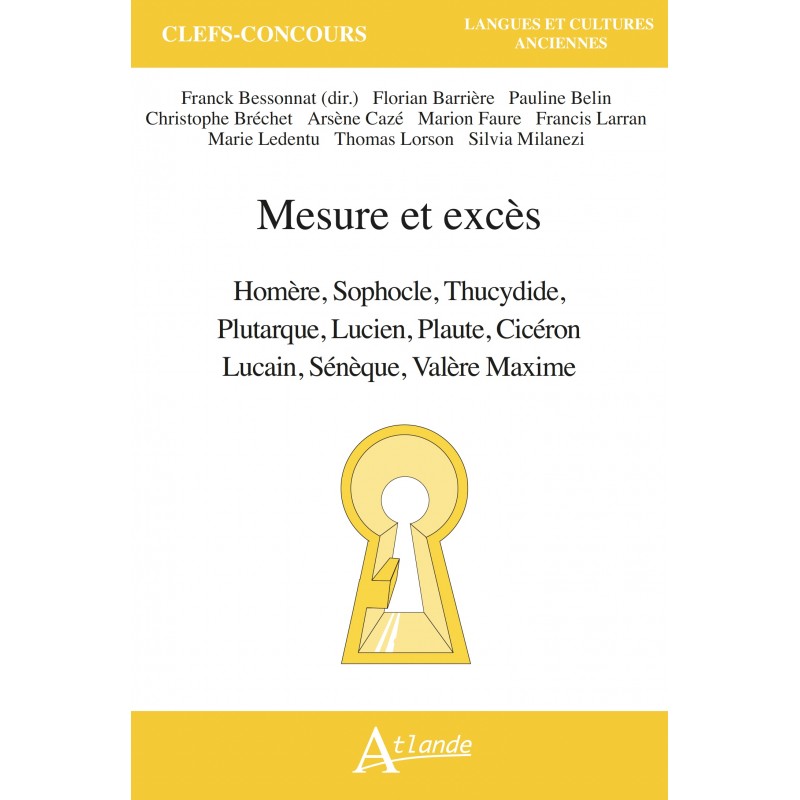
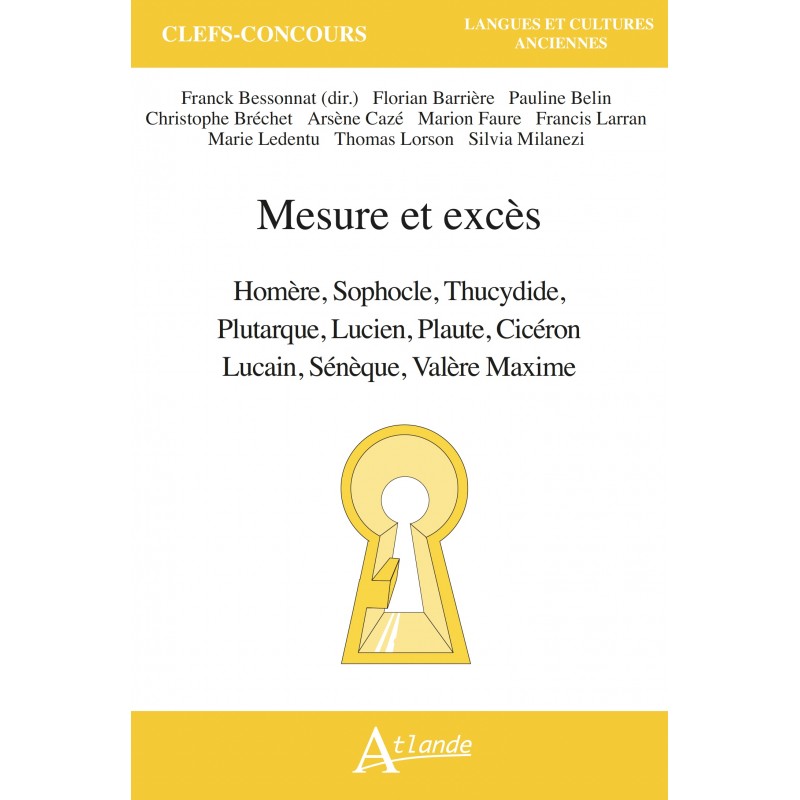
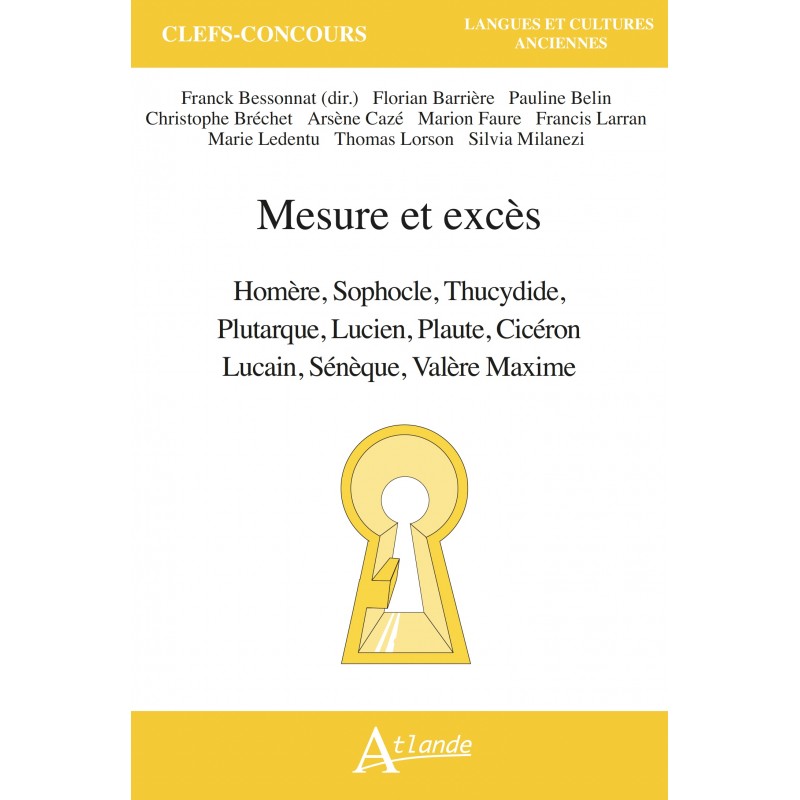

Fr. Bessonnat (dir.), Fl. Barrière, P. Belin, Ch. Bréchet, A. Cazé, M. Faure, Fr. Larran, M. Ledentu, Th. Lorson, S. Milanezi
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Clefs concours
S’adressant à tous les candidats aux concours, en particulier Agrégation et CAPES, Clefs concours offre une synthèse par sujet. Conçu comme un repère par rapport aux monographies et aux cours et comme un outil de révision, chaque ouvrage est articulé autour de fiches thématiques permettant de faire le point sur les acquis de la recherche. Synthèse des travaux les plus récents, Clefs concours permet de s’orienter dans la bibliographie et de mettre en perspective l’évolution des savoirs.
Clefs concours Langues et cultures anciennes
Tous les titres sont organisés autour d’une structure commune :
- des repères : un rappel du contexte historique et littéraire.
- le thème dans chacune des œuvres.
- des pistes pour le commentaire.
- des prolongements sur des œuvres comparables.
- des outils notamment bibliographiques.
Fiche technique
AVANT-PROPOS
QUELQUES CADRAGES MÉTHODOLOGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HOMÈRE, ODYSSÉE,
CHANTS VIII À XII
REPÈRES
LA PLUS ANCIENNE ÉNIGME DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ : HOMÈRE . . 27
LES ÉPOPÉES HOMÉRIQUES ET LES POÈMES DU CYCLE . . . . . . . . . . . . . . 31
PROBLÉMATIQUES :MESURE ET EXCÈS DANS LES CHANTS VIII À XII DE
L’ODYSSÉE
LE VOCABULAIRE DE LA MESURE ET DE L’EXCÈS DANS L’ODYSSÉE . . . . . 36
LA MESURE SELON ULYSSE :
LE CONCOURS ATHLÉTIQUE CHEZ LES PHÉACIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VORACITÉ ET CONFIANCE EN SOI CHEZ LES CICONES . . . . . . . . . . . . . . . 44
L’INCURIE ET LA GOURMANDISE DES COMPAGNONS D’ULYSSE
CHEZ LES LOTOPHAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CURIOSITÉ ET EXCÈS DE COLÈRE SUR L’ÎLE DU CYCLOPE . . . . . . . . . . . . 45
LA CURIOSITÉ, LA CONVOITISE ET LA CUPIDITÉ
DES COMPAGNONS D’ULYSSE AU RETOUR D’ÉOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LA CONVOITISE, LA VORACITÉ ET L’IMPIÉTÉ DANS L’ÎLE DU TRIDENT . . . 50
LA SÉDUCTION, L’AMOUR DE LA GLOIRE
CHEZ LES SIRÈNES, CIRCÉ ET CALYPSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ÉTUDE D’UN PASSAGE : XI, 100-139, ULYSSE CONSULTE TIRÉSIAS
FAUTES ET COLÈRE DIVINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
L’ἀτασθαλία d’Ulysse et la colère de Poséidon . . . . . . . . . . . . . . . 56
L’ἀτασθαλία des compagnons d’Ulysse et la colère d’Hélios . . . . 58
RETOURS À ITHAQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
La mort des prétendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Exil et apaisement de Poséidon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PROPOSITIONS POUR L’ENTRAÎNEMENT AU COMMENTAIRE . . . . . . . . . . . 65
MISE EN REGARD : MESURE ET EXCÈS DANS L’ODYSSÉE, CHANTS XVII À XX
LA MESURE FACE À L’EXCÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DE LA FOLLE INSOLENCE À L’YΒΡΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
OUTILS
PARTICULARITÉS DE L’ÉPOPÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Les vers épiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Épithètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Comparaisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Scènes typiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Le récit dans le récit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
REPÈRES CHRONOLOGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
SOPHOCLE, ANTIGONE
REPÈRES
LE THÉÂTRE ATHÉNIEN AU Ve SIÈCLE AVANT J.-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Origines et formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Contexte des concours dramatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
La représentation tragique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Corpus conservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Conception aristotélicienne de la tragédie : la mesure et l’excès . . . 99
SOPHOCLE ET ANTIGONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Le poète Sophocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Antigone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
• Date et représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
• Scène, espace et distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
La structure d’Antigone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PROBLÉMATIQUES :MESURE ET EXCÈS DANS ANTIGONE DE SOPHOCLE
DES CONCEPTIONS OPPOSÉES DE LA DIKÈ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ordre humain, raison et bienséance :
la conception de la mesure de Créon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ordre divin, primauté familiale :
la conception de la dikè d’Antigone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Le chœur et le garde :
mesure du commun face à la justice des puissants ? . . . . . . . . . . . 109
EXCÈS ET STASIS : ANTIGONE, UNE PIÈCE AU SUJET DE L’HYBRIS . . . . . . 112
Mesure et excès du tyran : le pouvoir en question . . . . . . . . . . . . . 112
Antigone, une figure excessive ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Thèbes, une ville sur le fil : stasis et désordre féminin . . . . . . . . . 116
LES EFFETS THÉÂTRAUX AU SERVICE DU RENVERSEMENT :
DE L’EXCÈS À LA MESURE, DE LA MESURE À L’EXCÈS . . . . . . . . . . . . . . 119
Les effets rhétoriques au service des différents agônes . . . . . . . . . 119
De la mesure à l’excès : la catastrophe tragique . . . . . . . . . . . . . . 121
ÉTUDE D’UN PASSAGE : V. 450-472, AFFRONTEMENT DE CRÉON ET ANTIGONE
REDÉFINITION DE LA SOUFFRANCE :
SOUFFRANCE PHYSIQUE ET PEINE MORALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
REDÉFINITION DE LA FOLIE :
DE L’EXCÈS D’ANTIGONE À L’AUDACE DE CRÉON . . . . . . . . . . . . . . . . 128
MISE EN REGARD : EURIPIDE, LES BACCHANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
OUTILS
NOTE SUR LA MÉTRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
THUCYDIDE, LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE,
LIVRES VI ET VII
REPÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS
DANS LES LIVRES VI ET VII DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE
LES PASSIONS DES STRATÈGES À LA QUESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Alcibiade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Nicias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
UNE FOLLE EXPÉDITION MONTÉE PAR UN ΔΗΜΟΣ IMPULSIF ? . . . . . . . . 154
L’EXPÉDITION DE SICILE, UNE AVENTURE OBÉISSANT
AUX LOIS UNIVERSELLES DE L’HISTOIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
L’EXPÉDITION DE SICILE, UN DÉSASTRE POUR DONNER À PENSER . . . . . 162
ÉTUDE D’UN PASSAGE : VII, 84, 1 – 85, 4,
L’ASSINAROS, TOMBEAU DES EXCÈS ATHÉNIENS
GYLIPPE AU MIROIR INVERSÉ DE NICIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Nicias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Gylippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
DE L’ORDRE AU DÉSORDRE, ET VICE VERSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
MISE EN REGARD:UNE LEÇON TRAGIQUE À LIRE DANS L’INTERTEXTUALITÉ
OUTILS
CHRONOLOGIE HISTORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
CHRONOLOGIE BIOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
PLUTARQUE, VIE D’ANTOINE
REPÈRES
VIE DE PLUTARQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
L’OEUVRE DE PLUTARQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
L’ENTREPRISE BIOGRAPHIQUE DES VIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
MIMÈSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
PLUTARQUE ET ROME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
ANTOINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
PLUTARQUE ET ANTOINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
UNE PLEINE CONSCIENCE DES FAIBLESSES HUMAINES . . . . . . . . . . . . . . 198
UNE ANTHROPOLOGIE PLATONICIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
ENTRE MORALISME ET ANALYSE PSYCHOLOGIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . 200
PROBLÉMATIQUES :MESURE ET EXCÈS DANS LA VIE D’ANTOINE
LES EXCÈS D’ANTOINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
LA MESURE DANS LA VIE D’ANTOINE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
RESPONSABLE, MAIS PAS COUPABLE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
ÉTUDE D’UN PASSAGE : XX, 3 – XXI, 4, LES OUTRAGES D’ANTOINE
MONTRER TOUTE L’ÉTENDUE DE L’HYBRIS D’ANTOINE . . . . . . . . . . . . . 212
CRÉER DES CONTRASTES, EXPLICITES ET IMPLICITES . . . . . . . . . . . . . . 215
RENDRE INTELLIGIBLES LA CONDUITE ET LA TRAJECTOIRE D’ANTOINE . 216
MISE EN REGARD :
COHÉRENCE DES PROJETS BIOGRAPHIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE PLUTARQUE
(COMMENT ÉCOUTER LES POÈTES, 8, 26A-27A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
OUTILS
OUTILS CHRONOLOGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Chronologie biographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Chronologie historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
LUCIEN, ALEXANDRE OU LE FAUX PROPHÈTE
REPÈRES
REPÈRES HISTORIQUES : L’EMPIRE ROMAIN AU IIe SIÈCLE . . . . . . . . . . . 229
REPÈRES LITTÉRAIRES : LA SECONDE SOPHISTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . 230
REPÈRES CULTURELS : LA PHILOSOPHIE ET LA RELIGION . . . . . . . . . . . . 232
REPÈRES BIOGRAPHIQUES : LUCIEN DE SAMOSATE . . . . . . . . . . . . . . . . 235
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS ALEXANDRE
ALEXANDRE OU L’EXCESSIF PROPHÈTE : LA SATIRE DES EXCÈS . . . . . . . 237
Des qualités hors normes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Un comportement excessivement mauvais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Une supercherie excessive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
L’excès de crédulité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
LA VOIX DU NARRATEUR : LA CONSTRUCTION D’UN ÉTHOS MESURÉ . . . 248
L’humilité et le bon goût face au projet littéraire hors normes . . . 248
La mesure épicurienne contre l’excès superstitieux . . . . . . . . . . . . 252
D’un excès l’autre : Alexandre et le satiriste . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
ÉTUDE D’UN PASSAGE : § 4, LE PORTRAIT MORAL D’ALEXANDRE
DES QUALITÉS INTELLECTUELLES EXCEPTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . 260
UN ÊTRE EXCESSIVEMENT VICIEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
L’ÉTHOS MESURÉ AFFICHÉ PAR LE NARRATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
MISE EN REGARD : LUCIEN, L’AMOUREUX DES MENSONGES . . . . . . . . .267
OUTILS
VILLES, RÉGIONS ET FLEUVES MENTIONNÉS DANS LE TEXTE . . . . . . . . . 273
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
PLAUTE, CURCULIO
REPÈRES
LA COMOEDIA PALLIATA ET SES CONVENTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
L’organisation des ludi scaenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Les différents types de spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
La palliata : une comédie grecque en latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Un théâtre chanté et dansé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Des intrigues conventionnelles (et quelques variations) . . . . . . . . 281
Organisation du temps et de l’espace scéniques . . . . . . . . . . . . . . . 282
Les conventions des personae comiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Mises en variation, ou comment créer du nouveau avec de l’ancien . 285
TITUS MACCIUS PLAUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Une vie mal connue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Les comédies de Plaute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
• Le corpus des comédies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
• Comédies du double, comédies du déguisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
• La ruse et ses meneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
• Métathéâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
• Un virtuose du verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
LA FÊTE DANS LES COMÉDIES DE PLAUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Le banquet, un motif comique dans l’Antiquité . . . . . . . . . . . . . . . 292
Une fête hyper-grecque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Les figures de la fête – ou un banquet de paroles . . . . . . . . . . . . . 295
ÉTUDE DE L’OEUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
La mise en jeu des conventions dans le Curculio . . . . . . . . . . . . . 298
• La structure du Curculio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
• Une variation majeure sur les conventions des personae comiques . . . . 306
• Le cas atypique du choragus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS LE CURCULIO
EXCÈS DU CORPS, EXCÈS DES MAUX :
MALADIE ET PLAISIRS, LES DEUX FACETTES DU PERGRAECARI . . . . . . . . 314
Vin et sexe : les frustrations de Phédrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Folie et indigestion(s) : les méfaits du pergraecari . . . . . . . . . . . . 317
L’anti-cena de Curculion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
ABONDANCE DE MOTS, CENSURE DES MOEURS :
DES FIGURES COMIQUES DE L’EXCÈS ET DE LA MESURE ? . . . . . . . . . . . 325
Les excès conventionnels du langage comique . . . . . . . . . . . . . . . 325
Mesure morale ou limites comiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
ÉTUDE D’UN PASSAGE : V. 110-140, LÉÉNA CHANTE LE VIN
LE NUMÉRO D’UNE AMOUREUSE DU VIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
UN DUO AMOUREUX DÉTOURNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
MISE EN REGARD : MESURE ET EXCÈS DANS LES ADELPHES DE TÉRENCE
LES SENTENTIAE DE DÉMÉA… ET DE SYRUS :
MISES EN JEU DE LA PAROLE D’AUTORITÉ DU SENEX . . . . . . . . . . . . . . . 345
LES EXCÈS DES DEUX SENES, CONSÉQUENCE DE LEUR RIVALITÉ LUDIQUE 349
OUTILS
CHRONOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
CICÉRON, SECONDE ACTION CONTRE VERRÈS,
LIVRE IV : DE SIGNIS
REPÈRES
LE PROCÈS DE VERRÈS : UNE AFFAIRE JUDICIAIRE ET POLITIQUE . . . . . 359
LA FIGURE DE CICÉRON DANS LE PROCÈS DE VERRÈS : ENJEU ÉTHIQUE 361
PLACE DU DE SIGNIS DANS LES VERRINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS LE DE SIGNIS
DE L’EXCÈS COMME MALADIE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
…À L’ANTI-RÉPUBLICANISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
L’impudentia, défaut éthique et politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Le détournement de la magistrature, paroxysme de l’excès . . . . . 373
LE RÉCIT DES EXCÈS AU SERVICE DE LA DÉ-ROMANISATION DE VERRÈS 376
Un homme indigne, un animal : une pensée philosophique et politique
de la dérégulation du comportement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
La figure du tyran et du barbare :
l’imaginaire collectif au service de la dé-romanisation . . . . . . . . . 378
LES SICILIENS REPRÉSENTÉS COMME DES ROMAINS ? . . . . . . . . . . . . . 383
LA FIGURE DE CICÉRON : ENJEUX THÉORIQUES ET POLITIQUES . . . . . . . 386
La rhétorique cicéronienne à l’épreuve de l’accusation :
excès ou mesure ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Cicéron, défenseur de la res publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
ÉTUDE D’UN PASSAGE : § 73-75, VERRÈS ET SCIPION
§ 73 : L’HISTOIRE AU SERVICE DU DISCOURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
§ 74 : UN TABLEAU VIVANT ET POLITIQUE DES HABITANTS DE SÉGESTE 397
§ 75 : LA DÉ-ROMANISATION DE VERRÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
MISE EN REGARD : MESURE ET EXCÈS DANS LES CATILINAIRES,
AU CENTRE DU COMBAT DE CICÉRON CONTRE VERRÈS . . . . . . . . . . . .403
OUTILS
CHRONOLOGIE BIOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
LUCAIN, LA GUERRE CIVILE,
CHANT I
REPÈRES
BIOGRAPHIE DE LUCAIN (39-65 AP. J.-C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
LE BELLVM CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Le titre du poème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Un poème inachevé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Contexte historique de la guerre civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Contexte historique du Bellum ciuile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Contexte littéraire de l’épopée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Structure du chant I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS LE CHANT I DU BELLVM CIVILE
UNE GUERRE CAUSÉE PAR LA DÉMESURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Une Rome en proie à l’excès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Les imperatores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Guerre civile et monde en guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Une épopée aux accents tragiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Prophétie et religion en quête de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
ÉTUDE D’UN PASSAGE : V. 673-695, LA MATRONE PROPHÉTIQUE
UNE MATRONE ROMAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
UN DÉLIRE PROPHÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
UN DÉLIRE POÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
MISE EN REGARD : MESURE ET EXCÈS
DANS LE CHANT VI DU BELLVM CIVILE DE LUCAIN
L’HÉROÏSME REMIS EN CAUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
RITES NÉCROMANTIQUES ET HORREUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
OUTILS
CHRONOLOGIE HISTORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
CHRONOLOGIE BIOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
SÉNÈQUE, DE LA CLÉMENCE
REPÈRES
VIE DE SÉNÈQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Sénèque avant Néron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Sénèque et Néron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
La mort de Sénèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
ŒUVRE DE SÉNÈQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Quelques mots sur le stoïcisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
L’œuvre philosophique de Sénèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Le De Clementia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS LE DE CLEMENTIA DE SÉNÈQUE
PRÉAMBULE : QUELQUES REMARQUES SUR L’ANALYSE
DU CONCEPT DE CLÉMENCE AVANT SÉNÈQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
LA CONSTRUCTION MINUTIEUSE D’UN CONCEPT COMPLEXE :
MESURER LA SPÉCIFICITÉ DE LA CLÉMENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Complexe et admirable clémence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Exécrables excès : l’art de la définition par le contraste . . . . . . . . 475
Une vertu politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
LES EXEMPLA : UNE GALERIE D’INCARNATIONS
DE LA MESURE ET DE L’EXCÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Des exemples historiques et “domestiques” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Des incarnations plus communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Néron, un exemplum en puissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
LA DÉMESURE, MENACE CONTRE NOTRE HUMANITÉ . . . . . . . . . . . . . . . 484
L’homme et l’animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
L’empereur et les dieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
L’ordre naturel du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
ÉTUDE D’UN PASSAGE : II, I, 1 – II, II, 1, “PUISSÉ-JE NE PAS SAVOIR ÉCRIRE !”
LA NARRATION D’UNE ANECDOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
UN ÉLOGE VIBRANT DU JEUNE PRINCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
ESPOIRS, ATTENTES ET IDÉAUX D’UN PHILOSOPHE . . . . . . . . . . . . . . . . 494
MISE EN REGARD : MESURE ET EXCÈS DANS LE THYESTE DE SÉNÈQUE
L’ŒUVRE DRAMATIQUE DE SÉNÈQUE : UN THÉÂTRE DE L’EXCÈS ? . . . . 497
L’EXEMPLE DU THYESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Une action cruelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Le triomphe de l’hybris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
OUTILS
CHRONOLOGIE BIOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
CHRONOLOGIE HISTORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
VALÈRE MAXIME, FAITS ET DITS MÉMORABLES,
LIVRES IV ET V
REPÈRES
VALÈRE MAXIME : L’AUTEUR, SON OEUVRE, SON PUBLIC . . . . . . . . . . . 513
POURQUOI ET COMMENT LIRE UN RECUEIL D’EXEMPLA ? . . . . . . . . . . . 516
Un ouvrage de références historiques et culturelles . . . . . . . . . . . . 516
Une galerie de portraits mémorables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Non pas lire, mais voir et parcourir la mémoire . . . . . . . . . . . . . . . 524
Un parcours dans une matière ordonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
PROBLÉMATIQUES : MESURE ET EXCÈS DANS LES FAITS ET DITS MÉMORABLES
UNE ÉTHIQUE DE LA MODÉRATION SOUS LE PRINCIPAT DE TIBÈRE . . . . 531
VERECUNDIA ET MORALE SEXUELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
MESURE ET EXCÈS : VERECUNDIA VS SEVERITAS PATRIS . . . . . . . . . . . . . 542
COMMENT ADOUCIR UNE FIGURE HISTORIQUE INCARNANT L’EXCÈS ?
UN PORTRAIT PARADOXAL DE MARC ANTOINE DANS LE LIVRE V
(PROPOSITION DE LECTURE SÉQUENTIELLE DE L’OEUVRE) . . . . . . . . . . . 547
ÉTUDE D’UN PASSAGE : V, 4, 1, CORIOLAN
UN SVMMVS VIR ET DES RENVERSEMENTS SUCCESSIFS DE FORTUNE . . . . 553
UNE SITUATION DE CRISE : L’IMPASSE DIPLOMATIQUE . . . . . . . . . . . . . . 556
LE DÉNOUEMENT D’UNE CRISE PAR LA PIETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
MISE EN REGARD : LA PERFORMANCE DE VÉTURIE FACE À CORIOLAN
DANS L’HISTOIRE LIVIENNE (II, 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
OUTILS
LISTE DES PERSONNAGES OBJETS DE VIGNETTES EXEMPLAIRES –
STRUCTURE DES CHAPITRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577
Franck Bessonnat, normalien, agrégé de lettres classiques, enseignant à l’université Jean-Moulin Lyon 3, chargé de la préparation aux agrégations de lettres et de grammaire au CNED, a assuré la direction de ce volume et rédigé les pages consacrées à Sénèque ainsi que l’avant-propos.
Florian Barrière, normalien, professeur des universités en langue et littérature latines à l’université Grenoble Alpes, a rédigé les pages consacrées à Lucain.
Pauline Belin, agrégée de lettres classiques, docteure en études latines, enseignante au collège Paul-Bert de Chatou, a rédigé les pages consacrées à Cicéron.
Christophe Bréchet, normalien, professeur des universités en langue et littérature grecques à l’Université Paris Nanterre et conseiller scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a rédigé les pages consacrées à Plutarque.
Arsène Cazé, normalien, agrégé de lettres classiques, enseignant à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, a rédigé les pages consacrées à Sophocle.
Marion Faure, normalienne, maîtresse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a rédigé les pages consacrées à Plaute.
Francis Larran, agrégé d’histoire, docteur en histoire grecque ancienne, enseignant en lycée, a rédigé les pages consacrées à Thucydide.
Marie Ledentu, professeure des universités en langue et littérature latines à l’université Jean-Moulin Lyon 3, a rédigé les pages consacrées à Valère Maxime.
Thomas Lorson, normalien, agrégé de lettres classiques et enseignant à l’université de Lille, a rédigé les pages consacrées à Lucien.
Silvia Milanezi, professeure honoraire d’histoire grecque à l’université Paris-Est Créteil, a rédigé les pages consacrées à Homère.
Ulysse ne peut pas goûter au plaisir du retour auprès de Pénélope et
de son enfant. Certes, les prétendants ont commis des actes insensés,
pleins de démesure ; pour autant, une fois qu’Ulysse les a tués, même s’il
bénéficie de la protection des dieux et particulièrement d’Athéna, il lui
faut expier son crime. En effet, celui qui se rend coupable d’ὕβρις,
de démesure, le meurtrier, doit rendre des comptes devant la famille des
morts et, devant la cité. En introduisant le μίασμα, “la pollution”,
“la contamination”, à l’intérieur de sa maison et de sa cité, le meurtrier
peut provoquer de nouveaux meurtres, voire la guerre ou la guerre
civile ; d’où le besoin de s’exiler et d’expier son crime. Voilà pourquoi
les coupables de meurtre dans l’épopée* homérique, dont Phénix,
Patrocle, Théoclymène*, sont de parfaits exemples : tous, après avoir
commis un meurtre, même involontairement, prennent la route de l’exil.
Pourtant, après avoir évoqué la mort des prétendants par la main
d’Ulysse, Tirésias ne fait pas clairement allusion à l’expiation à laquelle
doit s’adonner le héros. Sans transition, sans changer de phrase,
il se contente de lui dire qu’il lui faudra quitter son foyer (ἔρχεσθαι δὴ
ἔπειτα) avec, pour seul bagage, une rame facile à manier (λαβὼ ν εὐῆρες
ἐρετμόν) et se rendre là où les gens ignorent la mer (οἳ οὐ ἴσασι
θάλασσαν, XI, 120-121). Alors que le héros a longtemps erré sur la mer,
désormais il doit avancer, sans destination, vers l’intérieur des terres.
Tirésias ne précise pas dans quelle direction Ulysse doit marcher,
il se contente d’indiquer le bout de son voyage qui correspond aussi avec
son but. En effet, d’après le devin, il doit marcher jusqu’à ce qu’il fasse
la rencontre d’un homme qui prend sa rame pour une pelle à grain,
un homme qui ne connaît ni la mer, ni les navires, ni n’a jamais goûté du
sel (XI, 122-125). D’après certains spécialistes, l’aède s’inspire d’un de
ces pays lointains [HEUBECK et HOEKSTRA, 1988], un pays de légende,
au régime alimentaire particulier, tel celui des Lotophages* dont la
nourriture provoque l’oubli de soi et de la patrie. Cette contrée, vraisemblablement
lointaine, à laquelle se réfère Tirésias, devait intriguer le
public devant lequel se produisaient les aèdes* ou les rhapsodes*, étant
donné que les Grecs n’étaient jamais très éloignés de la mer.