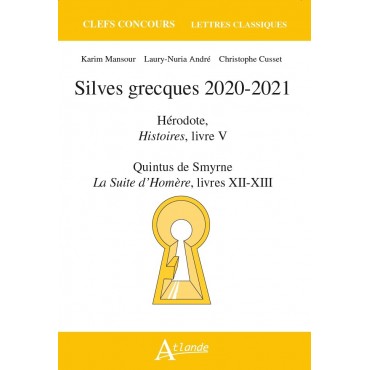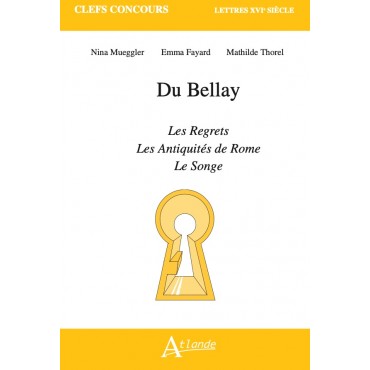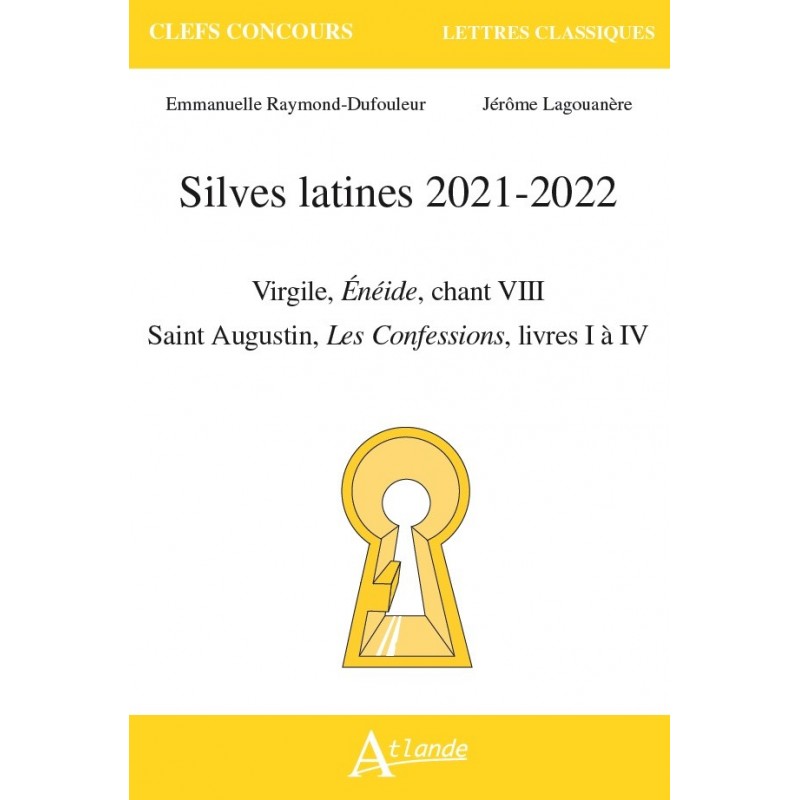
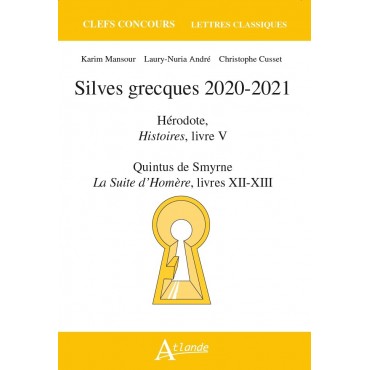
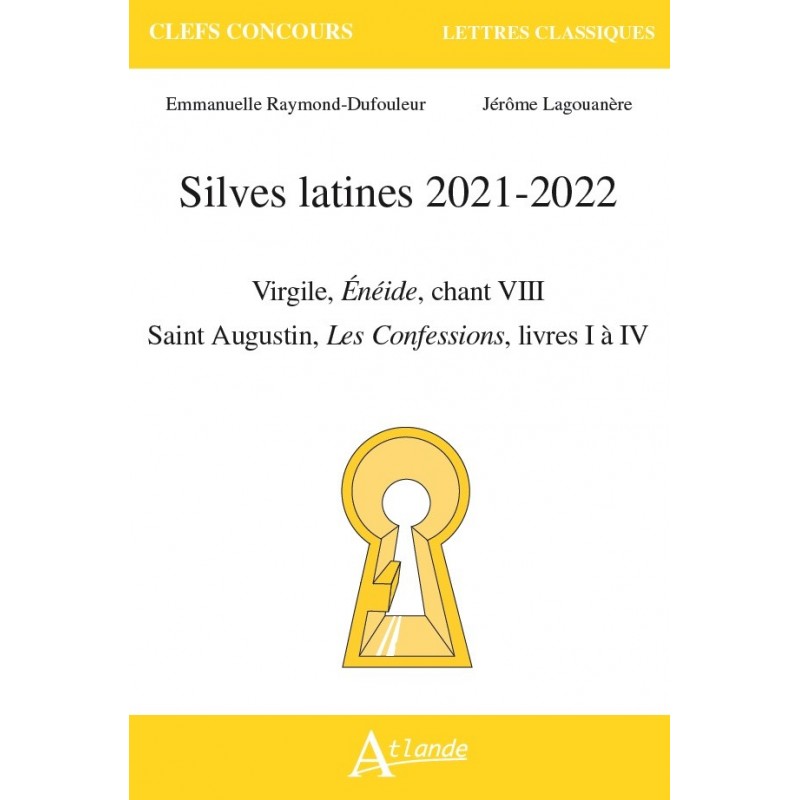
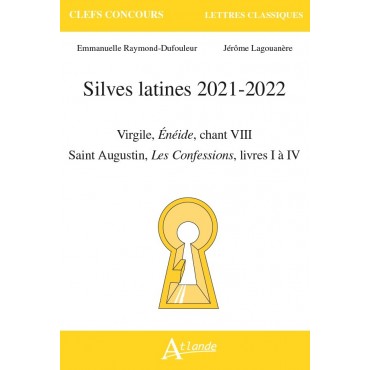
Emmanuelle Raymond-Dufouleur et Jérôme Lagouanère
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
LA référence pour l’agrégation de Lettres
Fiche technique
VIRGILE, ÉNÉIDE,
CHANT VIII
INTRODUCTION
“L’IMMENSE VIRGILE” (MART., EP. XIV, 186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Une vie, des Vies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Gloire et réputation d’un poète hors du commun . . . . . . . . . . . . . . .25
Cecini pascua, rura, duces : diversité de l’œuvre virgilienne . . . . .29
“LE PLUS BEAU MONUMENT QUI NOUS RESTE DE TOUTE L’ANTIQUITÉ”
(VOLTAIRE, ESSAI SUR LE GENRE ÉPIQUE, III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Quelques mots sur l’Énéide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Le livre VIII de l’Énéide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
REPÈRES
LE CONTEXTE POLITIQUE ET CULTUREL: LE SIÈCLE D’AUGUSTE
ENTRE RÉPUBLIQUE ET PRINCIPAT :
LA RES PUBLICA RESTITUTA SELON AUGUSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
RESTAURATION DE L’ORDRE ET DE LA MORALE :
LES VALEURS AUGUSTÉENNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
L’ARCHITECTURE ET LES ARTS AU SIÈCLE D’AUGUSTE . . . . . . . . . . . . . .49
LE CONTEXTE LITTÉRAIRE
LA LITTÉRATURE AUGUSTÉENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Les prosateurs au siècle d’Auguste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Les poètes augustéens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
LE GENRE ÉPIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Essai de définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Les différents types d’épopée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Le style épique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Le héros épique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
L’influence des épopées antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Homère et Apollonios de Rhodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Prémices de l’épopée romaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Aspects de l’originalité de l’épopée virgilienne . . . . . . . . . . . . . . . .76
ARCHITECTURE DU LIVRE VIII
LE COUPLE VII-VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PLAN DU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
PROBLÉMATIQUES
LE PERSONNAGE D’ÉNÉE AU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
UNE ÉVOLUTION CRUCIALE CHEZ LE HÉROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Un héros aux prises avec le passé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Signes d’un engagement personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Une pietas en action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Le temps de l’acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
ÉPIPHANIE D’UNE VICTOIRE ANNONCÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Affirmation d’un discours bienveillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Le dévoilement de la victoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Les moyens de la réussite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LE COMBAT D’HERCULE ET CACUS,
PRÉFIGURATION DE LA VICTOIRE D’ÉNÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Un combat manichéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Énée et le modèle herculéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Hercule, Énée et Auguste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
LE BOUCLIER DE LA VICTOIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Implications narratologiques du bouclier :
Énée armé pour la victoire finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
L’outil de la victoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Références littéraires et extratextuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Victoires et triomphes au cœur du bouclier . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
LE TEMPS ET L’ESPACE AU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
LE TEMPS, L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Une conjugaison des temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
• Le présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
• Le passé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Le passé de la diégèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Le passé mythologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
• Le futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Stratification des temporalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
• Cyclicité ascensionnelle du temps virgilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
• Le dialogue des mémoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
La poétique des lieux au livre VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
LE LIVRE D’AUGUSTE ET DE LA ROMANITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Réflexions sur l’identité romaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
• L’identité troyenne : manipulations narratives et enjeux . . . . . . . . . . . . .148
• Une identité romaine en construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Le prisme de l’idéologie augustéenne : défense et illustration . . . .155
• Grandeur et frugalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
• Guerre et paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
RELIGION ET DIVINITÉS AU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
UNE DÉFINITION DE LA RELIGION ROMAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
La religion du rite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
La religion du sacrifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Le culte de l’Ara Maxima et le carmen saliare de Virgile . . . . . . .178
LES DIEUX AU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
“Les dieux machinistes de l’épopée” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Le panthéon d’Auguste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
BOÎTE À OUTILS
CHRONOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
CARTE DES LIEUX DU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
LES PERSONNAGES DU LIVRE VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
STYLE, LANGUE ET MÉTRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
QUELQUES RAPPELS SUR L’HEXAMÈTRE DACTYLIQUE . . . . . . . . . . . . . .207
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Les coupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Les élisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
ÉLÉMENTS DE LANGUE ET DE MÉTRIQUE VIRGILIENNES . . . . . . . . . . . .210
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
AUGUSTIN,
LES CONFESSIONS I-IV
INTRODUCTION
LES CONFESSIONS, UNE OEUVRE UNIVERSELLE… . . . . . . . . . . . . . . . . .235
… MAIS INSCRITE DANS UN LIEU ET UN TEMPS DÉTERMINÉS . . . . . . . . 237
LES CONFESSIONS, UNE RÉVOLUTION LITTÉRAIRE ET SPIRITUELLE . . . .239
REPÈRES
L’AFRIQUE ROMAINE ET CHRÉTIENNE AUX IVe-Ve SIÈCLES APRÈS J.-C.
L’ORGANISATION POLITIQUE ET SOCIALE DE L’AFRIQUE
AU TEMPS D’AUGUSTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
L’arrière-plan politique et économique des Confessions . . . . . . . .243
La vie culturelle à Carthage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
L’AFRIQUE CHRÉTIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
La première Église chrétienne latine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Une Église divisée : le donatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
La persistance du paganisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Le cas du manichéisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
• La cosmologie manichéenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
• L’eschatologie manichéenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
• L’herméneutique manichéenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
• L’éthique manichéenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
• L’Église manichéenne en Afrique à l’époque d’Augustin . . . . . . . . . . .262
LES CONFESSIONS D’AUGUSTIN,
UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE ET SPIRITUEL
AUGUSTIN, UN HOMME DANS SON TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Une enfance et une jeunesse africaines (354-383) . . . . . . . . . . . . .266
Le séjour en Italie : de l’ambition du siècle
au retour vers l’Église catholique (383-388) . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Le retour à Thagaste et l’espérance d’une vie d’otium chrétien
(388-391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Augustin prêtre, puis évêque (391-401) :
la vie et l’œuvre d’Augustin lors de la rédaction des Confessions 272
DATES ET CIRCONSTANCES DE RÉDACTION DE L’OEUVRE . . . . . . . . . . . . 274
LES ANTÉCÉDENTS D’UNE OEUVRE SINGULIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Le récit de soi, une tradition antique et chrétienne . . . . . . . . . . . .276
Les premiers récits autobiographiques d’Augustin . . . . . . . . . . . .277
LA STRUCTURE DE L’OEUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
La question de l’unité de l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Résumé synthétique des treize livres des Confessions . . . . . . . . . .284
LA RÉCEPTION DES CONFESSIONS PAR SES CONTEMPORAINS . . . . . . . . .286
PROBLÉMATIQUES
LE GENRE LITTÉRAIRE DES CONFESSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
LE GENRE AUTOBIOGRAPHIQUE EN QUESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Un pacte autobiographique décentré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Une scénographie dialogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Un traitement original de la temporalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Confessions I-IV: un roman familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
LE GENRE DE LA CONFESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Confessio peccatorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Confessio fidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Confessio laudis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
LE GENRE PROTREPTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
CONFESSIONS I-IV. UN RÉCIT D’APPRENTISSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . .315
L’APPRENTISSAGE DES SAVOIRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
L’apprentissage du langage (Conf. I, 8, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Augustin et l’école romaine,
ou quand un discipulus devient un magister . . . . . . . . . . . . . . . . .317
• Augustinus discipulus (livres I à III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
• Augustinus magister (livre IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
La première oeuvre d’Augustin:
le De pulchro et apto (Conf. IV, 13, 20 - 15, 27) . . . . . . . . . . . . . .323
La lecture des Catégories d’Aristote par Augustin
(Conf. IV, 16, 28-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
L’enjeu culturel et spirituel de la lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
UN APPRENTISSAGE SOCIAL DÉCEPTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
La découverte de la sexualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
La découverte de l’amitié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
La découverte d’une ‘fausse religion’ :
l’adhésion d’Augustin au manichéisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
• Les motifs de l’adhésion d’Augustin au manichéisme . . . . . . . . . . . . . .335
• Augustin manichéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
• Le rejet du manichéisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
LE PÉCHÉ ET LA GRÂCE DANS LES LIVRES I À IV DES CONFESSIONS . .341
L’EXPÉRIENCE DU PÉCHÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
Le péché d’origine (Conf. I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
La triple concupiscence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
• La concupiscence de la chair : la uoluptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
• La concupiscence des yeux: la curiositas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
• L’ambitio saeculi : la superbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Un récit paradigmatique : le récit du vol des poires
(Conf. II, 4, 9 - 10, 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
L’INTERVENTION DIVINE DANS LE RÉCIT AUGUSTINIEN . . . . . . . . . . . . .355
La première conversion d’Augustin:
la découverte de l’Hortensius de Cicéron (Conf. III, 4, 7 - 5, 9) . .355
Le songe prophétique de Monique (Conf. III, 11, 19 - 12, 21) . . .358
L’amertume divine : la mort de l’ami (Conf. IV, 4, 7 - 9, 14) . . . .360
Le motif de la misericordia divine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, UN CHEF-D’OEUVRE LITTÉRAIRE . .365
CONTINUITÉ ET RUPTURES AVEC LA TRADITION CLASSIQUE . . . . . . . . . .365
La présence discrète de Salluste et d’Horace . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Le rapport d’Augustin au théâtre et à Térence . . . . . . . . . . . . . . . .367
Augustin et l’Énéide de Virgile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
Augustin et Cicéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
UN UNIVERS SYMBOLIQUE ET POÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Un imaginaire nourri du texte biblique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Entre prose et poésie, la poétique augustinienne . . . . . . . . . . . . . .375
• Le jeu des images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
• Quelques traits de la stylistique augustinienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Une écriture psalmique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377
BOÎTE À OUTILS
RETRACTATIONES II, 6, OU QUAND AUGUSTIN RELIT LES CONFESSIONS . 383
L’ÉTABLISSEMENT ET L’ÉDITIONS DU TEXTE LATIN . . . . . . . . . . . . . . . .384
L’impossible établissement du texte latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Éditions et principaux lieux variants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
• Principales éditions critiques du texte latin au XXe siècle . . . . . . . . . . . .384
• Principaux lieux variants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
LA LANGUE D’AUGUSTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
La question du ‘latin chrétien’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Caractéristiques du lexique augustinien en Conf. I-IV . . . . . . . . . .388
Principaux faits syntaxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
• Les subordinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Les subordonnées complément d’objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Les subordonnées circonstancielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
• Les éléments de la proposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
La négation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
Les formes nominales du verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
REPÈRES CHRONOLOGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
Emmanuelle Raymond-Dufouleur, agrégée de Lettres classiques, est maître de conférences en langue et littérature latines à l’université d’Angers. Auteur d’une thèse sur l’Énéide de Virgile (Forsan et haec olim meminisse iuuabit : Recherches sur les formes et aspects de la mémoire dans l’Énéide de Virgile, Lyon, 2011) dont elle prépare actuellement la publication, elle a dirigé l’édition du volume Vox poetae. Manifestations auctoriales dans l’épopée gréco-latine, Paris, De Boccard, 2011. Membre du Memoria Romana Project (sous la direction de Karl Galinsky) et collaboratrice au projet Hyperdonat (avec Bruno Bureau et Christian Nicolas), ses recherches portent sur la dialectique de la mémoire et de l’oubli de la fin de la République romaine à la fin du principat augustéen. Elle est également membre du Comité de rédaction de la revue Vita Latina.
Jérôme Lagouanère, agrégé de Lettres classiques, est maître de conférence HDR en langue et littérature latines à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 membre de l’équipe de recherche CRISES et de l’Institut d’Études Augustiniennes. Après une thèse intitulée Intériorité et réflexivité dans la pensée de saint Augustin préparée sous la direction de P. Cambronne et publiée en 2012 dans la Collection des Études Augustiniennes, il a mené des travaux sur la question du sujet et de l’altérité dans la philosophie antique, tout particulièrement dans l’œuvre d’Augustin. Il a édité ou coédité plusieurs ouvrages collectifs (Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique, Turnhout, 2015 ; La Naissance d’autrui, de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, 2019) et prépare une nouvelle édition critique et une traduction du De animae quantitate d’Augustin qui paraîtra dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne.
La découverte de la sexualité
La première de ces expériences vécue par Augustin est celle sur laquelle l’on a beaucoup glosé, pour ne pas dire phantasmé : la découverte de la sexualité. Pourtant, le récit qu’il nous en donne est des plus déceptifs. En effet, il ne nous donne guère de détails précis sur sa vie sexuelle à l’adolescence dans les livres II et III des Conf. : la sexualité n’y est finalement abordée que de manière symbolique, à l’aune d’une réflexion sur le péché (v. Le péché et la grâce). Par ailleurs, la description qu’Augustin en donne est assez décevante pour le lecteur en quête de détails grivois ; car, s’il dit très clairement le besoin qu’il avait besoin de jouir sexuellement de l’être désiré (Conf. III, 1, 1 : “Aimer, être aimé, m’était plus doux, quand je jouissais du corps de l’être aimé”), il ne nous dit ni avec qui, ni comment il a pu jouir, ce qui laisse la place à de très nombreuses hypothèses sur sa vie sexuelle, par exemple celle de rapports homosexuels (v. La concupiscence de la chair). En outre, la période de licence sexuelle qu’Augustin a connue s’avère extrêmement courte, puisqu’il se mit en couple avec une jeune femme à la suite d’une grossesse non désirée – jeune femme à qui il resta fidèle et qui lui donna un fils, Adéodat, dont on situe la naissance en 372 (Conf. IV, 2, 2). Étant donné qu’Augustin est arrivé à Carthage pour ses études en 370, cela signifie que sa période de licence sexuelle a duré un peu plus d’un an, ce qui est bien peu en définitive ! Enfin, et surtout, le constat qu’Augustin fait de cette expérience de la sexualité est en lui-même négatif et amer : “Je fus aimé ! j’en vins mystérieusement aux liens de la jouissance (ad uinculum fruendi), et joyeux je m’embarrassais dans un réseau de misère (aerumnosius nexibus), pour être bientôt livré aux verges de fer brûlantes de la jalousie, des soupçons, des craintes, des colères et des querelles” (Conf. III, 1, 1). Contrairement aux élégiaques romains qui pouvaient voir dans les querelles ou dans la jalousie le sel de la passion amoureuse, Augustin y décèle une logique mortifère. Il y a une part obscure du désir amoureux et sexuel qui conduit à tellement vouloir posséder l’autre et son corps, que l’on en vient à se perdre soi-même : le lien de la jouissance qui m’unit à l’autre est aussi le lien qui me condamne à me perdre moi-même.