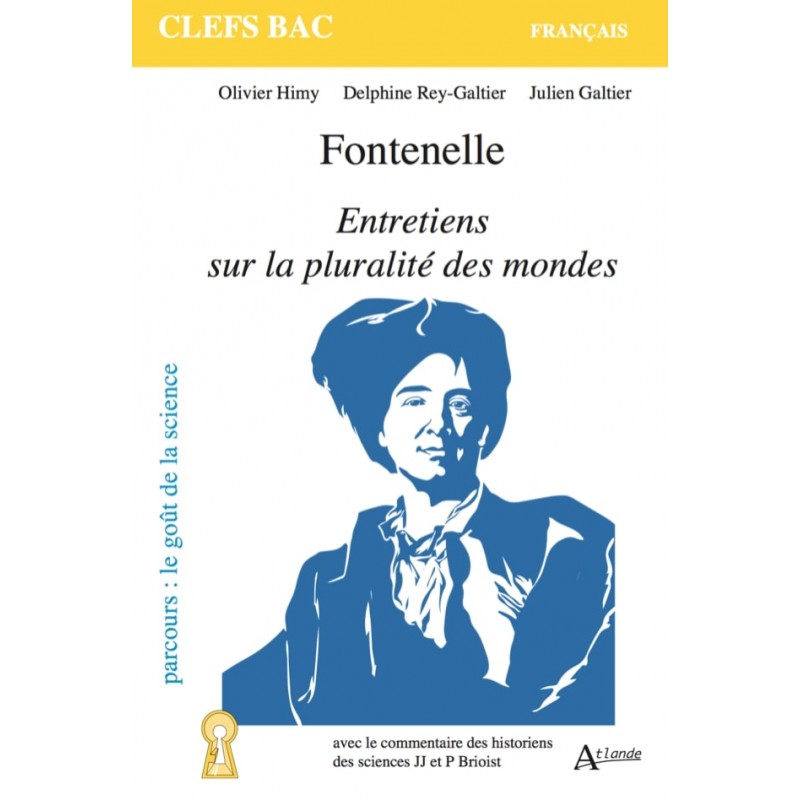
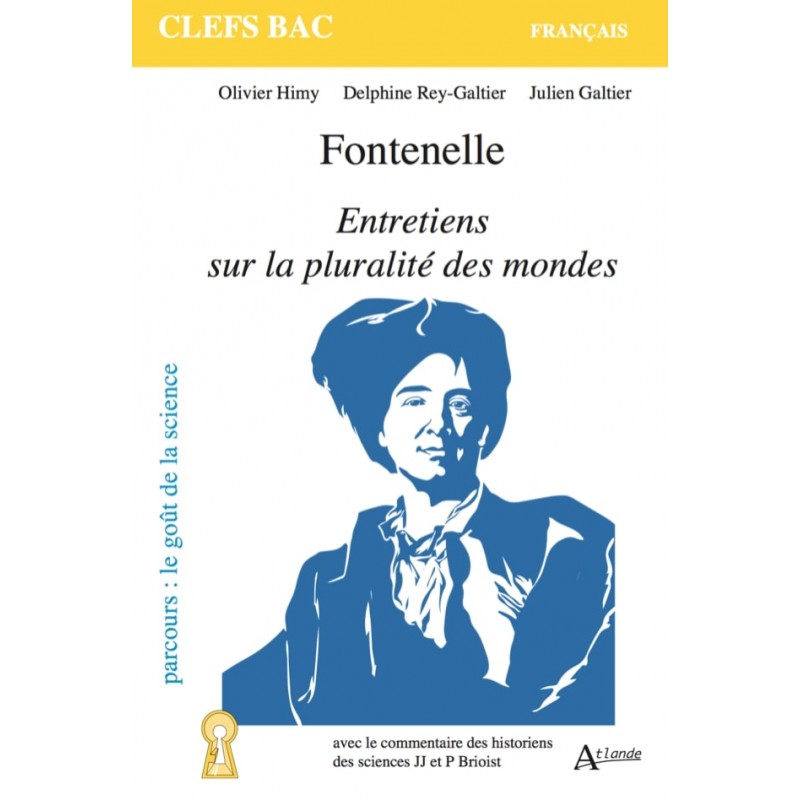
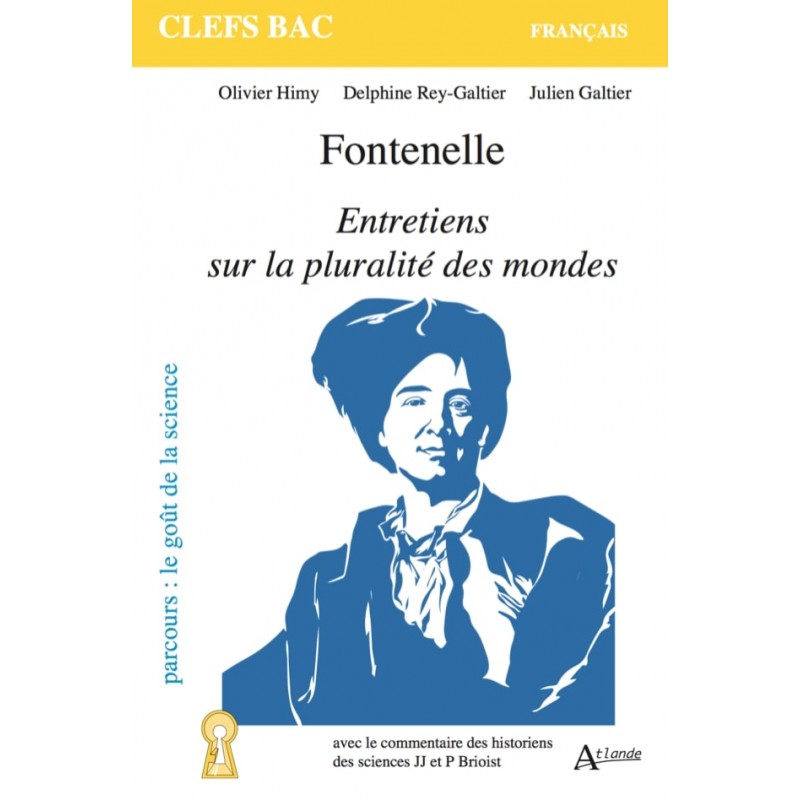
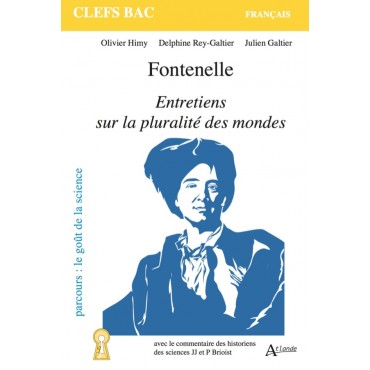
Par Olivier Himy, Delphine Rey-Galtier et Julien Galtier.
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Traitant de l’une des trois nouvelles œuvres au programme du bac de français pour les sessions 2025, 2026 et 2027, cet ouvrage offre un dossier complet et maniable dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs.
Cet ouvrage propose les éléments permettant, soit de faire cours sur le sujet, soit d’exceller dans la matière. Il se distingue donc nettement des volumes utilitaires autour des programmes.
Des QRcodes renvoient à des lectures différenciées des mêmes passages afin de faire prendre conscience au candidat des enjeux de la lecture.
Comme tous les Clefs bac, l’ouvrage comporte quatre parties :
Fiche technique
REPÈRES
Fontenelle dans son siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .20
Les révolutions de la pensée :
sciences et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Que sait-on ou que croit-on savoir ? . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Par quelles découvertes la publication
des Entretiens est-elle immédiatement suivie ? . . . . . . . . .26
Quel est l’impact de ces conceptions du monde
sur les croyances antérieures,
et notamment sur la question de Dieu ? . . . . . . . . . . . . . .27
• Le jansénisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Le libertinage érudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .32
Fontenelle dans les salons : le polygraphe mondain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Des prédécesseurs littéraires de Fontenelle à sa postérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Les voyages outre-monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
La tradition littéraire du dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Postérité des Entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .52
PROBLÉMATIQUES
Le parcours :“le goût de la science” . . . . . . . . . . . .57
Plaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Curiosité scientifique et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Se faire entendre des puissants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .65
Le cadre fictionnel des Entretiens :
le récit d’une aimable conversation mondaine ? . .69
Les seuils de la fiction : entrer par le paratexte . . . . . . . . .69
• Les “clefs” de la fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• La Lettre à Monsieur L... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Cadre spatio-temporel : moment propice à la rêverie . . . .74
• Des “rêveries” pastorales propices à la méditation :
le silence de la nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
• Le spectacle réjouissant de la nature :un autre seuil . . . . . . . . . . . . .76
Une aimable conversation mondaine ? . . . . . . . . . . . . . . .78
• Du récit à la conversation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Des saynètes plaisantes et facétieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
La poétique d’un “Bel esprit” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
La Marquise, une naïve lettrée ? . . . . . . . . . . . . . .82
La Marquise, figure du lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Du lecteur à la doxa : quelques naïvetés ? . . . . . . . . . . . . .83
• De quelques idées reçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
• Des idées rassurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Le sens commun vs les chimères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
L’illusion de la naïveté : les pertinences d’une lettrée curieuse . . . . . . . . . . . . . . . .86
• La Marquise ou la tentation de l’anthropocentrisme . . . . . . . . . . . .86
• Un personnage lettré et curieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Le chemin de la philosophie :
“et de là considérons l’univers”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Le goût de l’analogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
La mise en place d’une stratégie dictactique ..... . . . . . .93
Se familiariser avec la nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Pour mieux se projeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Représenter la science, représenter le monde :
les théories à l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Simplifier, instruire et divertir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
L’ancienne théorie du géocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
La théorie de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Le système de Tycho Brahé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Les mondes habités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Le dépassement de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Éléments d’une physique cartésienne . . . . . . . . . . . . . . . . .117
En finir avec les croyances
et le “faux merveilleux” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Copernic, selon le philosophe :
la genèse d’un nouveau récit scientifique . . . . . . . . . . . . . .124
Le temps des croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
• Un temps indéterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
• Un temps effrayant et sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
• Le temps de la magie et des superstitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Le peuple des “Anciens” ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
• Enfance de la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
• Les failles du présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
• Évacuer toute hiérarchie :des fables parmi d’autres . . . . . . . . . . . . .135
Le récit de l’astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
• Le sens des mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
• Un enchantement nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
• L’ironie à l’œuvre : distance et plaisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Le rôle des modèles – place du texte dans
la querelle des Anciens et des Modernes . . . . . . . .141
Quelques modèles antiques paradoxalement valorisés . . .142
Critique des modèles antiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Les modèles modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
• L’Astrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
• Le Roland Furieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Les “lunettes” des Entretiens :
un œil derrière le décor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Mise au point sur les “lunettes” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Le plaisir du visible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Les coulisses de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Les yeux et l’esprit : donner corps à l’invisible . . . . . . . . . .165
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .166
Pragmatique du décentrement . . . . . . . . . . . . . . . .167
Quitter le confort des théories reçues de la tradition . . 167
Lutter contre une pensée paresseuse . . . . . . . . . . . . . . 169
Vers le relativisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Accepter de ne plus être au sommet . . . . . . . . . . . . . . 171
Ébranler les certitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Aux fondements de la raison enquêtrice . ..........173
Apprendre à faire douter :
stratégies du philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Le dialogue a valeur d‘exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Le passage de l‘erreur à la vérité . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Penser l‘impensable, envisager l‘inconcevable . . . . . . .179
L‘histoire comme instrument pédagogique . ........ 180
La promotion du bon sens de la novice . . . . . . . . . . . . 182
Influencer les affects de la Marquise . . . . . . . . . . . . . .184
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . ........188
L’économie de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Le principe de simplicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
La métaphore de l‘enchère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Vers une morale du plaisir heureux . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Expérience scientifique, expérience littéraire :
refus de la littérature ou abandon à la littérature ? .199
Le refus de la littérature . ..................... 199
Le mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Le désir de littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Le goût de l’analogie et la rhétorique libertine 207
Ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Un philosophe séducteur . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 212
Une Marquise ambiguë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Les émois partagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
PARCOURS
La pluralité des mondes . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Cyrano de Bergerac,
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune. .. . . 226
Voltaire, Migromégas, 1752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Les entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Voltaire, Lettres philosophiques, Lettre I,
“Sur les quakers”, 1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** 250
Femmes galantes ou femmes savantes :
scènes de salons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Molière, Les Femmes savantes, extrait de la scène d’exposition 265
Ninon de Lenclos, La Coquette Vengée, 1659 . . . . . . . . . . .271
OUTILS
Circuler dans les Entretiens :
structure et perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Remarques préliminaires sur la structure . . . . . . . . . . . . . .281
Structure de la Préface :
un art poétique qui revendique le ”plaire et instruire” . . . .282
Structure des Soirs : introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Le Premier soir : “Que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même,
et autour du Soleil” . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Le Second soir : “Que la Lune est une Terre habitée” . . . . .288
Le Troisième soir : “Particularités du Monde de la Lune.
Que les autres Planètes sont habitées aussi.” . . . . . . . . . . .291
Le Quatrième soir : “Particularités des mondes de Vénus,
de Mercure, de Mars, de Jupiter et de Saturne.” . . . . . . . .294
Le Cinquième soir : “Que les étoiles fixes sont autant de Soleils, dont chacun éclaire un monde.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Le Sixième soir : “Nouvelles pensées qui confirment celles des Entretiens précédents.
Dernières découvertes qui ont été faites dans le Ciel.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Méthodologie de l’écrit de dissertation . . . . . . . . .305
L’introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
L’annonce du plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Les transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
La conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Rapport du sujet de dissertation avec le parcours .311
La nature de l’épreuve orale . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Les étapes de l’oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
La lecture expressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
L’explication linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Sitographie : un peu d’astronomie . . . . . . . . . . . .332
Olivier Himy est agrégé de Lettres modernes et docteur ès Lettres.
Delphine Rey-Galtier est agrégée de Lettres modernes et enseigne le théâtre au lycée de l'image et du son d'Angoulême.
Julien Galtier est agrégé de Lettres classiques et enseigne au lycée Marguerite de Valois à Angoulême.
• Le libertinage érudit
À bien des égards, le texte de Fontenelle relève de ce qu’on a appelé le libertinage*, mot dont il convient de préciser le sens. Dans libertinage, il y a liberté, et la première revendication des libertins, c’est la liberté de penser. S’il s’agit de penser librement, il s’agit alors d’être capable de remettre en cause les croyances, seraient-elles religieuses, et de ne croire que par soi-même, du fait d’un raisonnement et non d’un a priori. Il existe donc un courant appelé le “libertinage érudit”, constitué de penseurs qui ont cherché à se détacher des croyances préétablies pour refonder la connaissance sur un monde rationnel. Du point de vue de la méthode, cette refonda- tion de la pensée est celle exposée par le philosophe René Descartes, dans le Discours de la méthode. Sinon que Descartes ne tire pas les mêmes conclusions que nombre de ces libertins, en particulier quant à l’existence de Dieu.
La revendication d’une pensée libre de toute entrave ne peut évidemment être sans conséquence sur le mode de vie lui-même, et le libertinage, au sens moderne, trouve son origine dans ce libertinage érudit : en rejetant tout a priori, les libertins rejettent aussi ce qu’ils considè- rent dans le domaine des relations entre les sexes comme des convenances non fondées en nécessité. On retrouve cet aspect, comme en filigrane, dans le permanent jeu de séduction qui s’élabore entre le philosophe et la Marquise, tout au long du texte – nous y reviendrons.