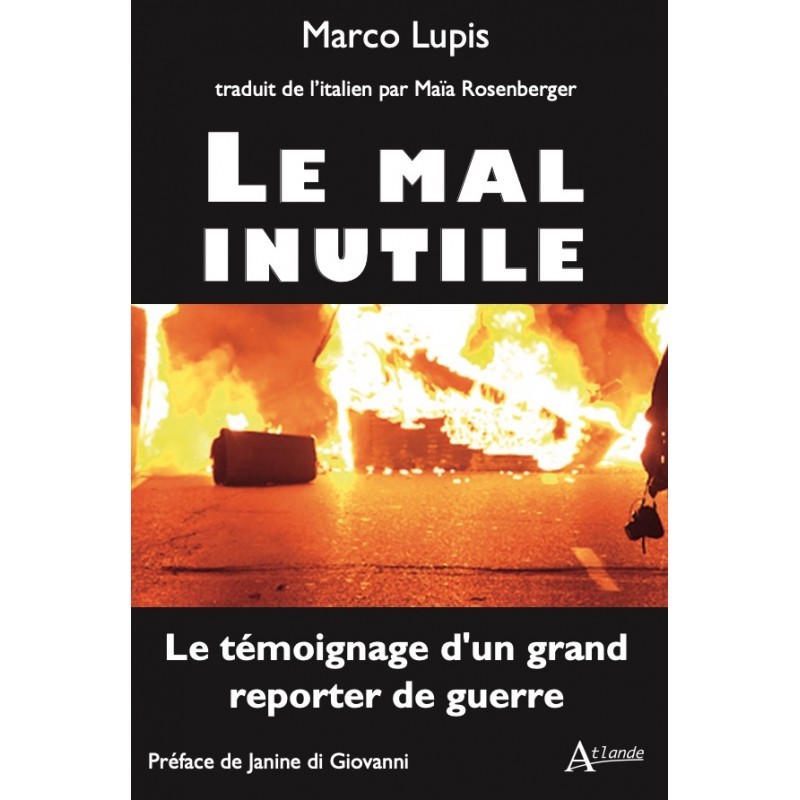
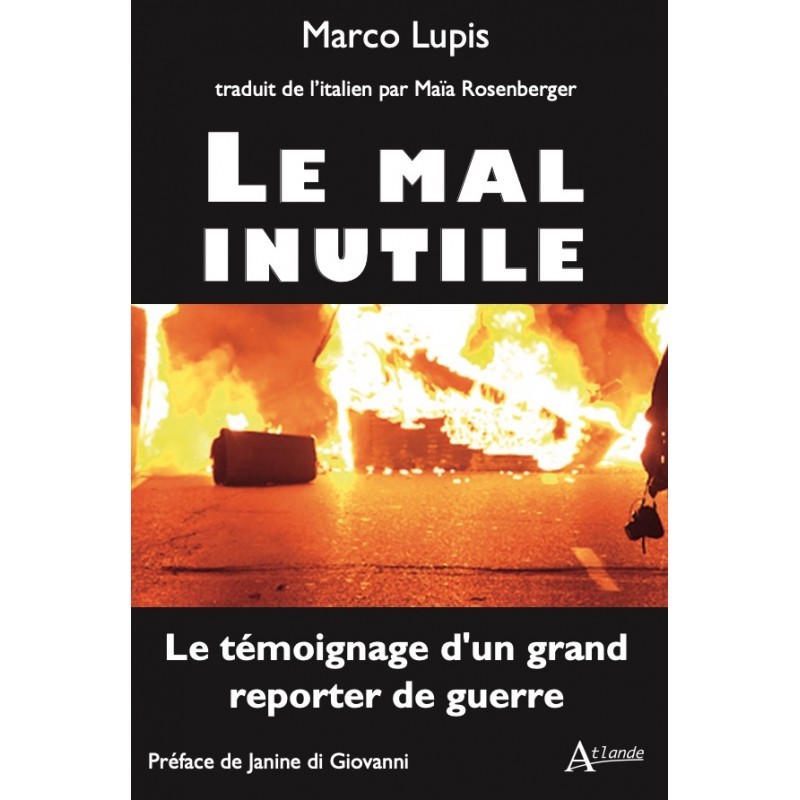
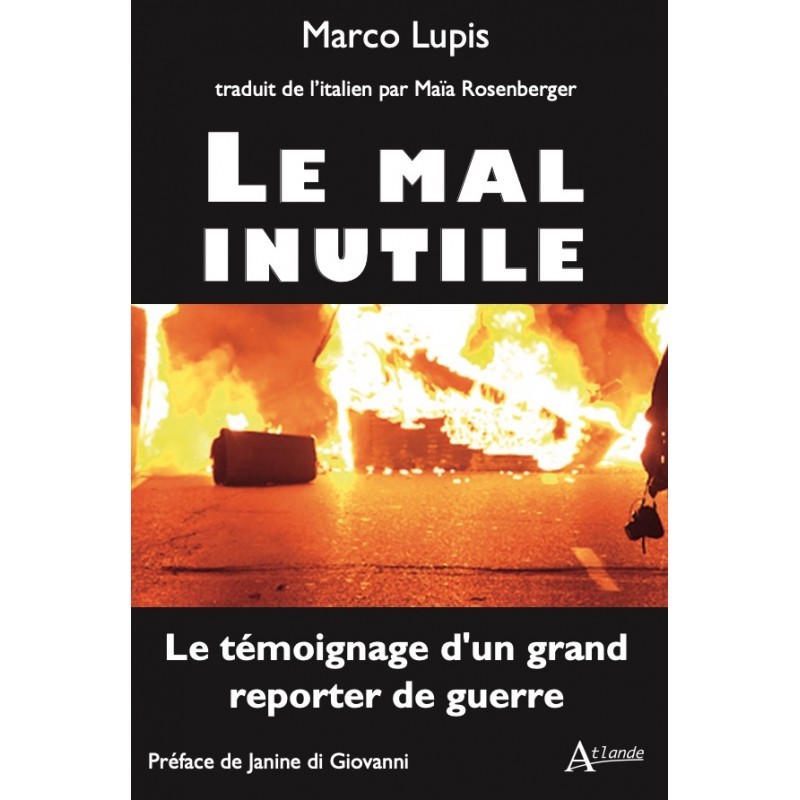
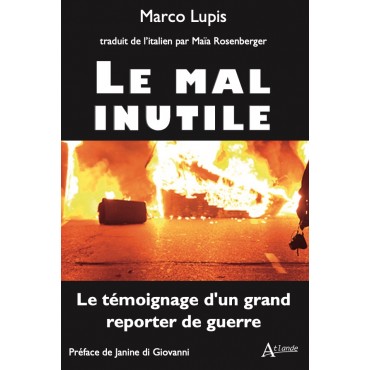
Par Marco Lupis.
Traduit par Maïa Rosenberger et préfacé par Janine di Giovanni.
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. : 5€ ⭢ 24€ d'achat, 10€ ⭢ 48€, 15€ ⭢ 96€, 20€ au-delà. DOM-TOM : 12€, 20€, 28€, 40€
Du Cambodge au Kosovo, de la guérilla du Chiapas à la mafia calabraise, 20 ans de conflits racontés par l'un des plus grands journalistes italiens. Le regard lucide, empathique et impliqué d'un journaliste-témoin qui paye un inévitable tribut personnel aux tragédies qu'il relate.
"Pour un journaliste, la guerre exerce un attrait irrésistible, inutile de le nier. Mais cela n'a rien à voir avec le comportement de chacal dont on accuse fréquemment la profession. Témoigner d'une guerre, d'une tragédie parfois lointaine et qui, sans notre travail, serait immédiatement oubliée", voilà sa raison d'être.
Fiche technique
Préface à l’édition originale par Janine di Giovanni
Préface à l’édition française
La fine ligne rouge
Prologue. “on veut juste les tuer, les tuer tous !”
Timor, 1999. Indépendance de sang
Japon, 1996. Les spectres du passé
Kosovo, 1999. À nos portes
Cambodge, 1997. on marche sur les os des morts
Indonésie, 1998. L’exterminateur de communistes
Chiapas, 1995. “¡Venceremos!” (tôt ou tard)
Chili, 1999. Ces roses sur le mur
Colombie, 2002. “Je serai peut-être tuée demain”
Putschistes dans le Pacifique, 2000
Moluques, 2000. Un massacre oublié
Philippines, 2002. Dans le repaire des coupeurs de têtes
Népal, 2000 .
Bali, 2002. Terreur au Paradis
Calabre, 2006-2016. Ma guerre personnelle
Conclusion, 2017
Remerciements
Index des noms
Marco Lupis est un journaliste, écrivain et correspondant de guerre italien, ayant notamment travaillé pour La Repubblica et le Corriere della Sera. Il a fréquenté de nombreuses zones de guerre et interviewé des personnalités politiques de premier plan (Aung San Suu Kyi , le sous-commandant Marcos...).
L’ouvrage est traduit de l’italien par Maïa Rosenberger.
Janine di Giovanni, grande reporter de guerre américaine, signe la préface.
“Ils tirent, putain!” Mon exclamation n’a été qu’un souffle. J’aurais voulu crier, mais ma voix ne sortait pas. on nous tirait dessus. Ils ne visaient personne d’autre, ils en avaient vraiment après nous !
Instinctivement, nous nous étions tous les trois accroupis derrière le muret, le photographe, Massimo Sciacca, de l’Agence Contrasto, mon collègue Maurizio Blondet, de Avvenire, et moi. Nos amies bonnes sœurs, plus habituées à ces situations et certainement plus lucides que nous, avaient dès les premiers tirs courus se barricader avec les enfants et les femmes dans le bâtiment où elles hébergeaient une cinquantaine de réfugiés. Nous n’en avions pas eu le temps et nous étions restés à l’extérieur, comme des idiots, derrière le muret. Ceux qu’ils voulaient, c’étaient les réfugiés que les Sœurs protégeaient, et pas nous, ça, rationnellement, je le comprenais. Mais je comprenais aussi qu’ils nous auraient tués d’abord pour arriver jusqu’à eux.
Je me suis tourné vers Sciacca et j’ai répété plus fort : “Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Ils viennent vers nous !” Massimo n’a rien dit, et pour toute réponse, a levé son appareil photo au-dessus du muret et s’est mis à appuyer en rafale sur le déclencheur. Lui non plus n’osait pas sortir la tête. Il prenait des photos sans regarder, en espérant qu’il y ait quelque chose dans le cadre.
J’avais eu le temps de les voir avant de me cacher, juste après les premières rafales de mitrailleuse. Ils étaient encore assez loin, mais j’avais quand même réussi à distinguer les bandanas sur leur tête, et surtout les armes automatiques qu’ils tenaient braquées devant eux en avançant dans les broussailles. J’avais aussitôt compris qu’ils voulaient attaquer la Mission et qu’ils allaient tous nous tuer.
Je n’ai pas pensé à mon fils qui n’avait que 9 ans. Je n’ai pas pensé à ma mère. Je n’ai pas prié. Je n’ai même pas revu ma vie tout entière défiler sous mes yeux en un éclair.
Je me suis préparé. Je me suis rendu compte que je ne cédais pas à la panique. Je n’avais même pas peur. Je n’étais envahi que d’une certitude lucide : j’allais mourir, c’était inévitable. J’espérais seulement que ça se passe sans trop de souffrance. J’avais vu la façon dont les miliciens utilisaient les machettes qu’ils portaient tous à la ceinture. J’en avais vu les effets sur les cadavres abandonnés dans les fossés, ou sur ceux que l’on remontait des puits. C’est pour ça que j’espérais seulement que tout aille vite. J’espérais une balle, une seule.
Quand j’avais quitté Jakarta deux jours avant, dans un avion affrété par l’Agence France Presse et rempli de journalistes occidentaux décidés à atterrir à l’aéroport de Dili – fermé au trafic aérien et sous le contrôle incertain des soldats australiens de la force de paix INTERFET (International Force for East Timor) – je savais que la situation était critique ; mais aucun d’entre nous ne pensait qu’elle l’était à ce point."